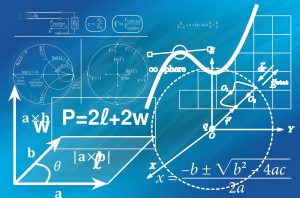Le potin de la semaine
Chez ADMA, comme vous le savez (on vous le dit et on assume), on aime les moutons à cinq pattes. Ces dossiers qui sortent du lot et qui, quand ils atterrissent chez nous, font hausser un sourcil avant de nous arracher un sourire. L’été, quand la jurisprudence fait la sieste, on en profite pour gratter dans nos affaires du quotidien.
Celui-ci a toqué en plein été, avec son air d’agneau malin : un locataire qui nous appelle, sûr de son coup, en brandissant fièrement l’article L. 145-39 du Code de commerce. « Je veux renégocier mon loyer, je m’appuie sur cet article, c’est mon joker. »
Le raisonnement semble tenir… jusqu’à ce qu’on lise vraiment le texte. Première piqûre de rappel : l’article L. 145-39 ne prévoit pas une négociation cosy entre locataire et bailleur, mais une révision judiciaire. Autrement dit, on ne discute pas autour d’un café, on va devant un juge. Et là, rien ne garantit que le loyer soit baissé. Le juge peut aussi décider qu’il reste tel quel, voire qu’il monte pour coller à la valeur locative.
Deuxième oubli, plus embêtant : notre client a zappé qu’après douze ans de bail, le déplafonnement est acquis pour le bailleur. Ici, le bail a été renouvelé le 1er janvier 2014, nous sommes en juin 2025. Le compteur a tourné, et cette épée de Damoclès ne joue pas en faveur du preneur.
Le fameux seuil de 25 % ? Oui, il est franchi, avec une variation de 26 %. Sur le papier, le locataire peut saisir le juge. Mais ce seuil n’est qu’un ticket d’entrée. Pour obtenir gain de cause, encore faut-il que le loyer, tel qu’indexé, soit manifestement excédentaire par rapport à la valeur locative. Et c’est là que nous intervenons : comparaison des loyers de marché, analyse des surfaces, des prestations, des clauses contractuelles.
En se glissant dans la peau de l’avocat du diable, on peut se demander : et si le bailleur profitait de cette procédure pour réclamer, lui, une augmentation ? Rien ne l’en empêche. Autre écueil : croire qu’il s’agit d’une négociation classique. Devant le juge, il n’est pas question de faire un cadeau au locataire ; le magistrat ne cherche qu’à vérifier la valeur locative. Si celle-ci dépasse le loyer actuel, c’est le locataire qui risque de se retrouver perdant.
En s’interrogeant sur l’opportunité d’une telle démarche, on peut se demander : est-il prudent d’engager une révision judiciaire avec un bail ancien où plane le spectre du déplafonnement ? Le bénéfice attendu compense-t-il vraiment le coût, le temps et l’aléa de la procédure ? Et si, par-dessus le marché, la valeur locative du secteur a explosé, le locataire ne risque-t-il pas de tendre au bailleur une perche qu’il s’empressera de saisir ?
Brandir l’article L. 145-39 comme un atout est tentant, mais il faut savoir que la partie n’est pas gagnée d’avance. Chez ADMA, on préfère prévenir que guérir, même quand on aime se frotter aux dossiers qui piquent.
Clés de répartition, clauses qui coincent : quand le bail de centre commercial devient un terrain de jeu juridique
Chez ADMA, on est pratico-pratique. On aime démonter les baux comme on démonte un vieux moteur : on regarde chaque pièce, on vérifie ce qui tourne rond et ce qui risque de grincer. En centre commercial, les baux commerciaux sont souvent des machines bien huilées par le bailleur, beaucoup moins par le locataire. Derrière leurs dizaines de pages, une question simple : est-ce un contrat d’adhésion ou un contrat de gré à gré ?
Depuis 2016, le Code civil distingue clairement les deux. Le contrat de gré à gré, c’est celui qui a été négocié, où chaque clause a pu être discutée. Le contrat d’adhésion, c’est l’inverse : un modèle figé, imposé par le bailleur, que le locataire signe sans avoir réellement voix au chapitre. Dans les centres commerciaux, c’est souvent cette dernière version qui domine, avec les mêmes obligations copiées-collées d’un bail à l’autre. L’article 1171, né de la réforme de 2016, est venu bouleverser un peu la donne. Il permet d’écarter les clauses qui créent un déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion. Cette arme, d’abord pensée pour protéger les consommateurs, a trouvé son chemin jusque dans les baux commerciaux. En 2022, la Cour d’appel de Paris l’a confirmé : un locataire peut s’en prévaloir, à condition de prouver que le bail est standardisé et que la clause contestée est manifestement abusive.
La date de signature devient alors déterminante. Avant 2016, l’article 1171 n’existait pas. Entre 2016 et 2022, la jurisprudence avançait prudemment. Depuis 2022, le terrain est plus favorable, mais encore semé d’embûches. Et l’un des champs de bataille les plus sensibles reste celui des charges locatives, en particulier la question des clés de répartition.
L’article L145-40-2 du Code de commerce précise que « Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires. ».
L’article L.145-40-2 du Code de commerce, applicable aux baux conclus ou renouvelés après le 1er juillet 2014, impose donc que le bail contienne un inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances, avec la répartition entre le bailleur et le locataire, une clé de répartition entre les différents occupants de l’ensemble immobilier et la quote-part exacte du preneur. Sans clé explicite, l’énumération des charges ne suffit pas. L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 2 mars 2022 (n°18/04413) l’a rappelé : une simple liste de charges à la charge du locataire, sans précision sur leur répartition, ne constitue pas un inventaire conforme. Le preneur doit pouvoir savoir dès la signature ce qu’il paiera réellement. Si le bail ne contient pas cette clé, certaines clauses sont réputées non écrites.
La Cour d’appel de Paris, le 15 mai 2019, a jugé que lorsqu’aucune clause ne prévoit le mode de répartition des charges, le bailleur ne peut pas l’imposer unilatéralement. Faute de clé contractuelle, les dépenses ne sont pas recouvrables. La Cour d’appel de Versailles, le 7 mars 2024, a même réputé non écrite une clause mettant à la charge du locataire certaines taxes car elle ne figurait pas dans un inventaire conforme. Le Tribunal judiciaire de Paris, le 14 novembre 2024, a ajouté que l’absence d’inventaire lors du renouvellement empêche toute refacturation, même si le bail initial prévoyait la répercussion. Enfin, la Cour de cassation, le 13 février 2025, a jugé que le preneur peut demander le remboursement des charges indûment facturées même après les avoir payées.
L’affaire Les Docks In Out c/ Joliette Bâtiments (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 janvier 2025) illustre ce terrain miné. Le locataire dénonçait un mode de répartition flou, notamment à cause de nombreuses cellules vacantes. La Cour a pourtant validé la clé basée sur la surface GLA, confirmé que les lots vacants étaient supportés par le bailleur et jugé que les charges étaient justifiées. Le preneur a perdu.
Ces décisions montrent que tout se joue dans la précision des stipulations contractuelles. Une clé absente, implicite ou modifiable unilatéralement ouvre une brèche. Une clé claire, appliquée conformément au bail, ferme la porte aux contestations.
En pratique, beaucoup de baux de centre commercial contiennent des charges lourdes, avec des répartitions qui varient et des annexes parfois incomplètes. C’est dans ces interstices que le contentieux prospère. Mais avant de foncer en justice, il faut mesurer l’enjeu financier et la solidité du dossier. Contester une répartition peut coûter cher, prendre du temps, et se retourner contre le locataire si le juge estime que tout est conforme.
Pour savoir si la bataille vaut la peine, mieux vaut faire appel à un expert. Lui seul peut analyser la mécanique du bail, vérifier la conformité des clés de répartition, éplucher les justificatifs de charges et dire si l’action a une chance d’aboutir. En s’interrogeant sur la stratégie, il faut aussi anticiper les réactions du bailleur et les effets domino dans un centre commercial : ce qui tombe pour un preneur peut rejaillir sur les autres.
Les baux en centre commercial sont rarement un terrain neutre. La frontière entre contrat d’adhésion et contrat négocié conditionne les moyens d’action du locataire. L’article 1171 du Code civil et l’article L.145-40-2 offrent des leviers puissants, mais ils ne se manient pas à l’aveugle. Chez ADMA, on préfère temporiser, et prendre le temps de l’analyse. Et cela commence toujours par une expertise sérieuse des baux et des charges, surtout quand les clés de répartition grincent ou manquent à l’appel.