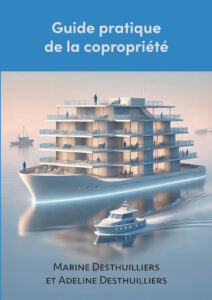Le potin de la semaine
Quand la réunion d’association vire au thriller juridique : entre promesses floues et loyers salés !
Ah, les réunions d’association, ces moments où l’on espère avancer sur nos projets, mais où les discussions peuvent rapidement se transformer en débats houleux sur les droits, les loyers et autres joyeusetés administratives. Voilà exactement ce qui s’est passé lors de notre dernière assemblée générale. Nous avions invité le maire adjoint, tout guilleret, pour qu’il nous présente le projet d’un tout nouveau bâtiment où nous pourrions poursuivre nos activités. Nous l’imaginions déjà, tout beau, tout neuf, prêt à nous accueillir. Mais voilà, on déchante vite quand on apprend que ce projet n’est encore qu’à l’état de brouillon et loin d’être validé. Bref, nous voilà à débattre sur des plans qui n’existent pas vraiment… Ah, les joies des promesses municipales !
Et comme si cela ne suffisait pas, il y a eu cette autre annonce, celle qui a fait bondir tout le monde de sa chaise : le Conservatoire du Littoral, décidément peu enclin à la générosité, nous réclame désormais la somme rondelette de 100 000 € par an pour l’utilisation de nos infrastructures actuelles. Là, c’était la goutte de trop. Une discussion pour le moins animée s’est alors engagée sur la légitimité de cette demande. Mais ce n’est pas tout. Il fallait aussi discuter du sort de notre cher immeuble, construit de nos mains sur un terrain que la commune nous avait gracieusement « prêté » depuis 1966. Vous imaginez bien qu’une telle situation ne se résout pas autour d’un simple café, et que des débats musclés sur l’indemnisation des bâtiments ont fusé dans tous les sens.
C’est à ce moment-là que, humblement, j’ai pris la parole pour proposer de jeter un coup d’œil sur les documents, histoire de savoir à quelle sauce nous allions être mangés. Parce qu’on peut bien crier à l’injustice, mais il vaut mieux d’abord vérifier ce que dit le contrat.
Et là, surprise : après une analyse minutieuse des archives (oui, il fallait bien se replonger dans la paperasse), il s’est avéré que ce que nous avions toujours cru être un bail n’était en réalité qu’une « convention de mise à disposition ». Et le Conservatoire du Littoral, en bon gestionnaire, souhaite maintenant nous imposer une « autorisation d’occupation temporaire » (AOT). Ah, la subtilité des termes juridiques !
La convention de mise à disposition et l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) sont deux cadres juridiques distincts concernant l’occupation de terrains ou de locaux appartenant à une collectivité publique ou à l’État. La convention de mise à disposition est généralement perçue comme un accord formel entre une autorité publique et une structure comme une association. Elle offre une certaine stabilité, car elle fixe les modalités de mise à disposition d’un bien public pour une durée déterminée, tout en assurant une collaboration réciproque entre les parties. Cette convention implique souvent un engagement sur le long terme, favorisant la continuité des activités et une planification financière structurée.
En revanche, l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) est un acte unilatéral, précaire et révocable, qui permet l’occupation d’un domaine public pour une durée limitée. Contrairement à la convention, l’AOT ne crée pas de droits réels sur le bien occupé et peut être interrompue à tout moment par l’autorité gestionnaire, créant ainsi une insécurité juridique pour l’occupant. De plus, l’AOT s’accompagne souvent d’une redevance à payer par l’occupant, ce qui peut peser lourdement sur la gestion financière des structures non lucratives, comme les associations.
Ah, les documents d’origine ! Ces chers papiers que l’on glisse dans un tiroir en se disant qu’on ne les regardera plus jamais… jusqu’au jour où tout le monde s’empoigne à propos de clauses et de conditions dont personne ne se souvient. Alors, mes amis, avant de partir en croisade juridique, il faut toujours faire une petite pause, respirer un bon coup, et surtout… revenir aux sources ! Car c’est bien dans ces vieux contrats, conventions et autres joyeusetés administratives que se cachent les fameuses petites lignes qui régissent nos relations. Les surprises ? Elles sont souvent au rendez-vous ! Ce qui ressemblait à un bail en bonne et due forme se révèle parfois être une convention de mise à disposition ou, pire encore, un engagement vaguement rédigé avec plus d’ambiguïté que de clarté. Bref, ne sous-estimez jamais le pouvoir d’une bonne relecture avant de se lancer dans des interprétations hasardeuses !
Les actualités
Bail commercial
Bail commercial – Charges et entretien
Dans cette histoire rocambolesque entre la société [Localité 10] Bowling et la Sci CLG, on se croirait presque dans une série judiciaire où les deux parties se renvoient la balle, mais pas sur une piste de bowling cette fois-ci ! L’enjeu ? Pas une simple partie de quilles, mais bien des milliers d’euros de charges et de taxes foncières qui se baladent entre les mains du bailleur et celles du locataire.
Tout commence en 2006, avec un bail commercial signé en grande pompe : 205 000 euros de loyer annuel, et quelques clauses bien senties sur l’entretien du centre commercial. Jusque-là, tout roule comme sur des roulettes… sauf que rapidement, le locataire commence à se poser des questions sur l’état des lieux. La Sci CLG, censée assurer un environnement commercial au poil, traîne un peu les pieds. Les escalators font des caprices, la lumière clignote plus souvent que celle d’un mauvais disco, et les sols… disons qu’ils auraient bien besoin d’un petit coup de polish.
Notre locataire décide donc d’envoyer quelques boules dans la cour de justice, réclamant à grand fracas que le bailleur prenne ses responsabilités et qu’il arrête de lui refiler des charges qui lui paraissent, disons, un peu salées. La Sci CLG, elle, n’entend pas se laisser faire et décide de répliquer. Après tout, ces charges ne sont-elles pas prévues dans le contrat ? Une bonne partie de ping-pong judiciaire s’engage donc, avec la société Bowling qui réclame des comptes sur des montants qu’elle juge, comment dire… exagérés.
Le tribunal, un peu perplexe devant ce match endiablé, ordonne une expertise. L’expert est chargé de mettre les choses au clair : qui doit quoi à qui, et surtout, est-ce que tout ce micmac de charges est bien justifié ? La Sci CLG se retrouve à devoir justifier chaque facture, chaque euro réclamé. Et là, surprise : certaines factures semblent avoir pris la poudre d’escampette. Oups ! Pas de bol pour la Sci CLG, qui se voit condamnée à rembourser les sommes trop perçues pour certains exercices.
Mais attention, ce n’est pas fini ! Parce que dans cette partie, il faut aussi compter les taxes foncières, et là encore, c’est le casse-tête pour savoir qui doit payer quoi. Un peu comme dans un vieux feuilleton où chaque épisode amène son lot de rebondissements, la cour d’appel finit par trancher : la société Bowling doit payer certaines sommes, mais pas tout, et la Sci CLG devra mettre la main au portefeuille pour rembourser le trop-perçu. Comme quoi, même dans les histoires de baux commerciaux, la justice sait distribuer des strikes !
Et le comble de l’histoire, c’est que tout ce bazar judiciaire, qui aurait pu se régler autour d’un café et d’un bon vieux tableau Excel, a fini par coûter cher à tout le monde. Ah, les joies des relations bailleur-locataire, quand elles se transforment en véritable sitcom juridique…
Bail d'habitation
Bail d’habitation – Clause de solidarité
Ah, la clause de solidarité dans un bail d’habitation, cette petite subtilité juridique qui fait souvent grincer des dents ! Vous pensiez qu’en signant un bail à deux, chacun pourrait tranquillement partir de son côté sans rien devoir à l’autre ni au propriétaire ? Détrompez-vous ! Ce n’est pas aussi simple, surtout lorsque la clause de solidarité entre en jeu, et là, on commence à jongler avec les arriérés de loyers, les intérêts légaux et les indemnités d’occupation. Oui, ça devient vite aussi compliqué qu’une partie d’échecs avec plusieurs pièces manquantes.
Dans l’affaire qui nous occupe, Mme W et M. Z, tout fraîchement locataires d’un joli appartement (merci à la société Seqens), avaient initialement décidé de vivre en colocation, partageant le loyer et sans doute aussi les factures du ménage. Seulement voilà, comme dans toute bonne histoire, les choses se sont compliquées. Madame a pris congé et a quitté l’appartement après quelques différends (on parle de violences conjugales, pas vraiment une brouille sur qui a laissé traîner ses chaussettes). Pendant ce temps, Monsieur, pas vraiment dans l’idée de partir, a préféré rester tranquillement dans l’appartement… sans pour autant s’acquitter des loyers.
Mais, c’est là que la clause de solidarité montre tout son potentiel. Car même si Mme W a pris ses clics et ses claques en mai 2021, la société Seqens, elle, s’en tient au contrat. Et le contrat dit que, solidarité oblige, Mme W reste dans la danse pour encore quelques mois ! En effet, selon l’article 4 des conditions générales du bail, la solidarité perdure jusqu’à deux ans après le départ d’un des colocataires. Oui, vous avez bien lu : deux ans ! Même si vous êtes parti en Patagonie et que vous ne comptez plus jamais revoir votre ex-collocataire (ou ex-partenaire), vous êtes toujours redevable des loyers impayés.
Madame W, pas franchement enchantée par cette idée, décide alors de faire appel au juge. Et pour cause : cette clause lui paraît bien abusive. Elle invoque alors l’article L. 212-1 du code de la consommation, qui protège les pauvres consommateurs face aux clauses abusives des professionnels. Et dans ce cas, Mme W n’a pas tort ! La commission des clauses abusives avait d’ailleurs pointé du doigt ces clauses qui prolongent injustement la solidarité, créant un déséquilibre significatif entre les parties. Surtout qu’en 2014, la loi Alur avait introduit un petit changement sympathique : la solidarité dans une colocation ne peut plus durer que six mois maximum après le départ du colocataire. Et paf, ça remet les pendules à l’heure !
Le tribunal de proximité de Poissy, saisi de cette affaire, tranche donc : cette clause de solidarité de deux ans ? On la range au placard. Elle est déclarée nulle et non écrite. Mme W n’est donc plus solidairement responsable des loyers à partir de décembre 2021, six mois après son départ. Ouf, voilà une bonne nouvelle pour elle ! Mais, vous savez ce que c’est, dans les histoires de bail, il y a toujours des arriérés qui traînent. Madame W se retrouve quand même à devoir partager un peu les dettes accumulées jusqu’à son départ. Eh oui, tout n’est pas toujours aussi rose qu’on le souhaiterait…
Et M. Z, dans tout ça ? Il ne s’en tire pas à si bon compte. Celui qui a continué à occuper l’appartement doit évidemment rembourser les arriérés de loyers, les charges, et toutes les autres joyeusetés liées à l’occupation des lieux après la résiliation du bail. En prime, il doit même indemniser Mme W pour le préjudice moral qu’elle a subi. Après tout, être trainée dans une procédure pour des dettes qu’elle n’a pas contractées, ça laisse des traces. Verdict : 1 000 euros pour le préjudice moral. Ce n’est pas la fortune, mais c’est toujours ça de pris.
Alors, moralité de l’histoire : si vous signez un bail en colocation, jetez un œil à la clause de solidarité avant de vous engager. Parce que même si vous avez fait vos valises, vous pourriez bien continuer à payer pour un loyer que vous ne profitez plus… et ça, c’est loin d’être la meilleure façon de rompre les liens avec son ex-colocataire !
Copropriété : Permis de construire
Ah, la copropriété… Un univers aussi riche en rebondissements que les meilleures séries télévisées ! Entre les permis de construire refusés, les voisins qui s’opposent systématiquement à tout projet, et les allers-retours devant les tribunaux, il y a de quoi perdre son latin (et son calme). C’est un peu l’histoire de M. [I] et de la SCI Avenir, dont les péripéties pourraient faire l’objet d’une bonne saga judiciaire.
Tout commence avec une copropriété assez particulière : deux lots seulement, l’un comprenant une maison, l’autre le droit de construire sur une partie du terrain. Jusque-là, tout va bien. La SCI Avenir obtient un permis de construire pour un pavillon en 2008, mais les choses se gâtent rapidement : M. [I], propriétaire du lot voisin, n’a visiblement pas envie d’avoir un pavillon en face de chez lui. Et voilà qu’il s’oppose avec toute la vigueur d’un copropriétaire contrarié lors de l’assemblée générale en 2010.
Le litige s’enflamme lorsque la SCI Avenir se voit refuser l’autorisation de travaux par l’assemblée des copropriétaires. Pas de problème, se dit-elle, direction le tribunal pour obtenir une autorisation judiciaire, en vertu de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965. Le tribunal lui donne gain de cause en 2013, mais M. [I], n’étant pas du genre à se laisser faire, conteste le permis de construire devant le tribunal administratif, et voilà que ce dernier annule le permis. La suite ? Un imbroglio juridique digne d’un film noir, avec recours devant la Cour administrative d’appel, annulation de l’annulation par le Conseil d’État, et tout cela pour en revenir, des années plus tard, à valider finalement ce permis initialement délivré en 2008.
Mais entre-temps, la SCI Avenir a manqué de sérieux revenus locatifs. Elle attaque donc M. [I] pour abus de son droit de vote en assemblée générale, arguant qu’il a bloqué son projet sans justification valable. La cour d’appel lui donne raison, soulignant que M. [I] avait bien connaissance du projet dès l’achat de son lot, et qu’il n’a démontré ni atteinte à la destination de l’immeuble, ni préjudice à ses droits de copropriétaire. Bref, son opposition procédait davantage d’une volonté de préserver son petit confort personnel plutôt que de défendre un intérêt commun, ce qui caractérise un abus de majorité (ou plutôt ici, d’égalité, les deux copropriétaires détenant chacun 50 % des tantièmes).
Résultat des courses : M. [I] est condamné à indemniser la SCI Avenir pour le préjudice économique causé par l’absence de revenus locatifs. Une belle leçon sur l’usage (ou l’abus) du droit de vote en copropriété, où chaque décision peut avoir des conséquences financières lourdes.
D’ailleurs, cette affaire est un rappel judicieux qu’en copropriété, l’opposition systématique, même si elle est un droit, peut se transformer en abus lorsqu’elle bloque injustement les projets des autres. Comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris, les droits des copropriétaires ne sont pas sans limites, surtout lorsqu’ils sont exercés au détriment des intérêts collectifs. Alors, avant de lever la main pour dire « non » à tout, il vaut mieux s’assurer que l’on n’est pas en train de franchir la ligne rouge qui sépare le droit légitime de l’abus.
Une petite note juridique pour briller lors de la prochaine assemblée : cette décision s’appuie sur les principes de responsabilité civile énoncés à l’article 1240 du Code civil (anciennement 1382), qui prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Alors, si vous êtes copropriétaire, gardez bien en tête que votre droit de vote doit être exercé de bonne foi, et surtout, dans l’intérêt collectif !
Et si vous pensiez que le feuilleton judiciaire était terminé, détrompez-vous : il y aura toujours une prochaine assemblée, une nouvelle opposition, ou une autre petite clause du règlement de copropriété à interpréter… Mais n’oubliez jamais, la justice, elle, veille, et les abus finissent toujours par être sanctionnés, comme dans cette affaire qui, après des années de procédures, a finalement ramené tout le monde à la raison.
Copropriété : Compte bancaire séparé
Dans le domaine de l’immobilier, la réglementation autour des syndics de copropriété est comme une vieille recette de grand-mère. On y trouve des ingrédients essentiels, une pincée de formalités à respecter, un soupçon d’obligations juridiques, et bien sûr, des règles précises à suivre sous peine de voir le gâteau s’effondrer.
Prenons par exemple l’histoire du syndic de copropriété et de son fameux compte bancaire séparé. Pour les non-initiés, cette règle, inscrite dans la loi du 10 juillet 1965, pourrait paraître un simple détail administratif. Mais attention, c’est bien plus qu’un formalisme : c’est une pierre angulaire du régime juridique de la copropriété.
En effet, la loi impose au syndic d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires dans un délai de trois mois suivant sa désignation. Pourquoi tant de rigueur, me demanderez-vous ? Eh bien, imaginez un syndic jonglant avec les finances de plusieurs copropriétés dans un seul et même compte. Ce serait comme mélanger les comptes des invités lors d’un grand banquet : très vite, on ne saurait plus qui a payé quoi, et les mécontentements fleuriraient plus vite que des mauvaises herbes au printemps. Le compte séparé est donc là pour éviter toute confusion et garantir la transparence financière, évitant au syndic de jouer les acrobates bancaires avec l’argent des autres.
C’est précisément là que se trouve le nœud de bien des affaires judiciaires, comme celle du Cabinet Delomier. Dans ce cas, notre syndic avait manqué à cette obligation en ouvrant son compte un peu tard. La justice ne s’est pas montrée compréhensive face à ce retard, car, comme le dit la jurisprudence, le défaut d’ouverture d’un compte séparé entraîne automatiquement la nullité du mandat du syndic. Et là, peu importe que tout le reste ait été fait dans les règles de l’art ; si le syndic oublie ce détail capital, il risque de voir ses efforts balayés d’un revers de main.
La jurisprudence est claire et ferme sur ce point. Par exemple, dans une affaire jugée par la Cour de cassation en 2016 (pourvoi n° 14-23.898), il a été confirmé que le syndic ne pouvait prétendre à aucune rémunération pour la période où son mandat était annulé. C’est comme si un chef cuisinier tentait de faire payer son plat après avoir brûlé le gâteau. Impossible, dit la loi. Le mandat étant annulé, tout ce qui en découle est également frappé de nullité.
Ainsi, les tribunaux veillent au grain, rappelant que les règles de la copropriété ne sont pas là pour décorer les étagères poussiéreuses du droit immobilier. Elles s’appliquent avec une rigueur que l’on pourrait presque qualifier de pointilleuse, mais qui n’a d’autre but que de protéger les copropriétaires contre des pratiques douteuses ou négligentes.
Pourtant, tous les syndics n’apprennent pas leur leçon, et c’est ainsi que les tribunaux continuent de rendre des décisions fermes, annulant des mandats et obligeant les syndics fautifs à rembourser les honoraires perçus. Chaque décision est une piqûre de rappel : les obligations légales sont là pour être respectées, et chaque manquement peut coûter cher.
Dans l’histoire du Cabinet Delomier, la leçon est claire. Pour un syndic, ne pas respecter ses obligations revient à jouer avec le feu. Le droit, tel un maître de cuisine exigeant, ne tolère pas d’improvisation dans la préparation du plat réglementaire. Il veille à ce que tous les ingrédients soient respectés à la lettre. Et gare à ceux qui voudraient s’aventurer à jouer les chefs rebelles dans la cuisine du droit immobilier : la jurisprudence les ramènera rapidement à l’ordre.