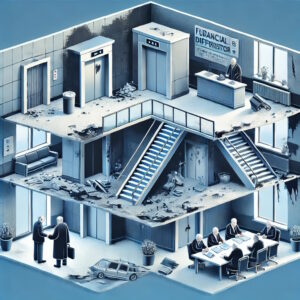Le potin de la semaine
Les RNEI ont encore tenu toutes leurs promesses : deux jours intenses, riches en échanges, en débats et en belles rencontres. Ces journées rappellent à quel point notre métier d’expert se nourrit du collectif, du dialogue et de la confrontation des pratiques. C’est toujours un moment à part, une parenthèse dans nos agendas chargés, pour réfléchir autrement, prendre du recul, croiser les expériences… et retrouver les copains.
L’édition 2025 a rassemblé un public attentif et curieux autour d’intervenants venus de tous horizons. Les échanges ont été francs, souvent passionnés c’est d’ailleurs ce qui fait la richesse de ces rencontres : chacun arrive avec ses certitudes, mais repart avec de nouvelles idées à tester sur le terrain.
De notre côté, nous avons animé la formation sur la ventilation comptable terrain/construction. Petit moment de solitude au départ : certains pensaient qu’il s’agissait de la méthode “sol et construction” ! Finalement, le sujet a suscité de nombreux échanges autour des approches comparatives, des pratiques de promoteurs, des méthodes de calcul et… de la fiabilité (ou de l’absence) des données. Les débats entre notaires, experts, services du Domaine et promoteurs ont été particulièrement riches. Notre présentation, fondée sur des cas concrets et un regard sur la jurisprudence (notamment l’arrêt du CE du 15 février 2016), a été saluée pour sa clarté et son ancrage dans la pratique quotidienne, fidèle à notre devise : pratico-pratique. Merci aux nombreux participants.
Comme toujours, la diversité des thèmes abordés a illustré la vitalité du métier d’expert. Cette année, il a été question de redevances domaniales, d’évaluation de fonds de commerce, de divisions en volumes, d’énergies vertes, de boulangeries-pâtisseries, de risques climatiques, de valeurs vertes, d’hôtels, de loyers, de servitudes, de sites industriels, de pharmacies (excellente intervention de praticiens de terrain), d’intelligence artificielle ou encore de conversion de bureaux en logements. Le tout mené par des intervenants expérimentés : inspecteurs des finances publiques, experts judiciaires, géomètres, universitaires, ingénieurs ou dirigeants.
Derrière cette diversité, un fil conducteur : relier la technique à la pratique. Comprendre comment les règles s’appliquent vraiment sur le terrain, rendre le droit et l’économie plus lisibles et cohérents. C’est sans doute ce qui fait le succès des RNEI : on repart avec des outils concrets et une vision renouvelée de notre métier.
Une chose est certaine : l’expertise évolue vite. Les outils changent, les méthodes s’affinent, les enjeux environnementaux s’imposent, et l’intelligence artificielle entre peu à peu dans nos pratiques. Ces évolutions ne sont pas théoriques : elles sont déjà présentes dans nos dossiers. Les RNEI permettent d’en débattre collectivement, d’échanger sur ce qui fonctionne (ou pas), et d’avancer ensemble.
Ces rencontres rappellent aussi que l’expert n’est pas un technicien isolé. Il est un maillon essentiel de la chaîne judiciaire et économique, un observateur du réel, un passeur de sens. Et c’est en confrontant nos points de vue que notre pratique gagne en solidité et en justesse.
Enfin, les RNEI, c’est aussi tout ce qui se passe en dehors des salles : les discussions de couloir, les échanges autour d’un café, les idées qui naissent entre deux interventions. Ces moments informels font partie intégrante de la richesse de l’événement.
On repart de là avec le carnet d’adresse plein, la tête en ébullition et le sentiment d’appartenir à une communauté engagée. Chez ADMA Expertise, on en retient une conviction forte : le savoir n’a de valeur que s’il circule, et la qualité d’une expertise dépend autant de la méthode que de la curiosité de celui qui la mène.
Expropriation pour cause d’utilité publique : le juge peut dépasser l’offre de l’expropriant, mais pas celle du commissaire du gouvernement
L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 octobre 2025 apporte une précision importante sur le rôle du juge de l’expropriation et la portée de l’article R. 311-22 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Il répond à une question récurrente en pratique : jusqu’où le juge peut-il aller lorsqu’un exproprié ne répond pas aux offres de l’administration et ne produit aucun mémoire ?
L’affaire oppose l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane, agissant pour la communauté d’agglomération du Centre littoral, à la société civile immobilière Goldust Immobiliaria. L’expropriation portait sur un terrain, et le débat ne concernait plus que la fixation de l’indemnité de dépossession.
L’exproprié n’ayant pas répondu à l’offre de l’administration, ni pendant la phase amiable ni devant le juge de l’expropriation, celui-ci avait accordé une indemnité supérieure à l’offre initiale, mais conforme à l’évaluation du commissaire du gouvernement. L’établissement public s’y est opposé, estimant qu’en l’absence de mémoire de l’exproprié, le juge devait se limiter strictement au montant proposé par l’expropriant.
L’article R. 311-22 prévoit que « le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant ». Si l’exproprié n’a pas notifié son mémoire dans le délai de six semaines, il est réputé s’en tenir à ses offres ou à ses réponses. Et si aucun mémoire n’a été déposé, « le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose ».
L’expropriant plaidait une lecture stricte : sans mémoire, le juge ne pourrait dépasser l’offre initiale.
La Cour de cassation rejette cette interprétation. Elle rappelle que le commissaire du gouvernement est partie à la procédure, et que le juge, en l’absence de réponse de l’exproprié, doit se fonder sur l’ensemble des éléments dont il dispose, parmi lesquels la proposition du commissaire du gouvernement, même lorsqu’elle est supérieure à celle de l’expropriant.
Autrement dit, le silence de l’exproprié ne fige pas le juge dans l’offre de l’administration.
Le juge peut fixer une indemnité supérieure à celle-ci, à condition de ne pas dépasser la proposition du commissaire du gouvernement.
Cette position consacre une logique d’équilibre :
- lorsque l’exproprié participe à la procédure et formule une demande, le juge ne peut statuer au-delà de cette prétention ;
- lorsqu’il s’abstient totalement, le juge n’est pas enfermé par l’offre de l’expropriant, mais seulement plafonné par la proposition du commissaire du gouvernement.
Dans le cas d’espèce, l’expropriant offrait une indemnité principale de 3 819 €, assortie d’une indemnité de remploi de 763,80 €. La cour d’appel avait fixé respectivement ces montants à 10 830 € et 1 874,50 €, conformément à la proposition du commissaire du gouvernement. La Cour de cassation valide cette appréciation et rejette le pourvoi.
La décision est cohérente, mais elle interroge.
En permettant au juge de retenir la proposition du commissaire du gouvernement, même supérieure à l’offre administrative, la Cour valorise le rôle de ce dernier comme garde-fou technique. Mais on peut douter de la neutralité réelle de ce commissaire, souvent issu de la même administration que l’expropriant.
Le risque est de donner une apparence d’équité là où le contradictoire a disparu.
On peut aussi s’interroger sur les effets pervers de cette jurisprudence : si l’absence de mémoire ne pénalise pas l’exproprié, celui-ci pourrait être tenté de ne pas se manifester, espérant bénéficier d’une évaluation plus favorable du commissaire du gouvernement. La cohérence procédurale en souffre, car la logique même du débat contradictoire est affaiblie.
Le juge de l’expropriation conserve toutefois une marge d’appréciation : il n’est pas tenu par la proposition du commissaire du gouvernement, mais il ne peut pas aller au-delà. Il doit toujours motiver sa décision en fonction des éléments concrets du dossier : nature du bien, références de marché, conditions locales, vocation du terrain et préjudice de remploi.
Ce faisant, la Haute juridiction réaffirme que l’expropriation n’est pas un contentieux ordinaire, mais une procédure mixte, à la frontière du judiciaire et de l’administratif, où le juge doit préserver un équilibre entre l’intérêt général et la protection du droit de propriété. Le commissaire du gouvernement joue un rôle central dans cet équilibre.
Son évaluation, souvent issue de services fiscaux ou de l’administration, n’a pas un caractère contraignant mais constitue un repère. Lorsqu’il n’existe pas de mémoire contradictoire de la part de l’exproprié, cette évaluation devient la seule borne supérieure légitime.
En pratique, pour les experts et praticiens, cette décision rappelle plusieurs points :
- Le silence de l’exproprié n’empêche pas le juge de fixer une indemnité plus juste, mais il limite le contradictoire ;
- Le commissaire du gouvernement demeure le pivot du dossier, sa proposition servant de borne supérieure ;
- L’expert judiciaire doit, dans ce contexte, examiner avec vigilance la cohérence de cette proposition : méthode utilisée, choix des comparables, éventuels biais liés à la nature administrative de la mission ;
- Enfin, il est toujours préférable que l’exproprié dépose un mémoire, même succinct, pour préserver sa position procédurale et contribuer à la transparence du débat.
Cette affaire rappelle une vérité constante : dans le droit de l’expropriation, le silence n’est jamais neutre. Il ne vaut ni consentement, ni renonciation, mais ouvre la voie à une décision façonnée par d’autres.