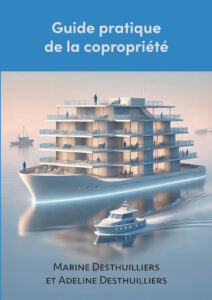Le potin de la semaine
C’est toujours au moment où on pensait les comptes bouclés que tombe une régularisation oubliée. Trois colonnes, des tantièmes et une note finale qui laisse songeur. Tout le monde regarde les chiffres, mais peu regardent les délais. Or, en matière de charges, le temps peut faire basculer la facture du côté de l’oubli comptable.
Pour les locataires d’habitation, la règle est stricte. La loi du 6 juillet 1989 impose un délai d’un an pour régulariser les charges. Si le bailleur s’y prend trop tard, il ne peut plus rien réclamer. Même si la régularisation est fondée, c’est trop tard. Un an, pas un jour de plus. Du côté locataire, bien que l’article 2224 du Code civil fixe en principe un délai de prescription de cinq ans pour les actions personnelles, y compris celles relatives à la restitution d’indus, ce délai général s’efface devant les règles spécifiques applicables au contrat de bail d’habitation. En matière de contestation des charges locatives, c’est l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi ALUR, qui s’applique prioritairement : il prévoit un délai de prescription de trois ans, à compter de la régularisation annuelle des charges. Autrement dit, le locataire ne peut contester des sommes réclamées au titre des charges qu’à l’intérieur de cette période triennale, les dispositions de droit commun ne trouvant à s’appliquer qu’à défaut de règles spéciales.
Pour les locataires en bail commercial, c’est une autre affaire. Depuis la loi Pinel, l’article L. 145-60 du Code de commerce fixe un délai de trois ans pour toute action fondée sur le bail. Cela vaut pour les loyers impayés, les charges récupérables, les régularisations tardives, les contestations de provisions, mais aussi pour les manquements à une clause du bail. Le bailleur peut revenir sur trois exercices, pas davantage. Et le preneur, de son côté, dispose du même délai pour contester un appel de charges excessif ou demander le remboursement de sommes indues. Mais attention : si les charges sont refacturées au titre d’un contrat distinct du bail (contrat de prestations, services, fluides), on peut retomber dans le délai de prescription droit commun de cinq ans.
Chez les copropriétaires, pas de distinction : tout repose sur la prescription de droit commun prévue à l’article 2224 du Code civil. Cinq ans pour réclamer, cinq ans pour contester. Le syndicat dispose de ce délai pour recouvrer les charges impayées, et le copropriétaire pour soulever une erreur de ventilation, une quote-part mal calculée ou une dépense sans base contractuelle ni vote. Là encore, tout commence à courir à compter du jour où le copropriétaire a eu connaissance des appels, soit généralement à la réception de l’appel de fonds ou du procès-verbal d’assemblée.
En pratique, ce sont toujours les mêmes qui règlent les charges les yeux fermés, et ceux qui relisent les baux, les annexes ou les PV avec un café serré. Les premiers paient, les seconds discutent. Et parfois, ils ont raison. Moralité : avant de signer le chèque, mieux vaut jeter un œil à la date. Parce qu’en matière de charges, on peut contester longtemps… mais pas indéfiniment.
Chez ADMA, quand une demande sort de notre champ ou dépasse notre périmètre, on ne ferme pas la porte. On cherche la solution adaptée et, surtout, on prend le temps de conseiller.
Le fisc ne voit pas les gravats, seulement les mètres carrés
Travaux en cours, taxe foncière maintenue : l’arrêt rendu le 5 mai 2025 par le Conseil d’État, confirme une lecture stricte des articles 1516 et 1517 du Code général des impôts. La SARL Pamier, espérait la décharge des impositions établies en 2021 sur trois entrepôts du Blanc-Mesnil alors partiellement dénudés ; toitures et façades avaient disparu, seules les structures béton subsistaient. Le tribunal administratif de Montreuil avait rejeté la demande ; le pourvoi n’a pas franchi la phase d’admission devant le Conseil d’État, malgré une question prioritaire de constitutionnalité formulée sur l’égalité devant les charges publiques. La Haute juridiction à estimer que les travaux, faute d’être achevés, ne constituaient pas un changement de caractéristiques physiques au sens du premier alinéa du I de l’article 1517.
Le cœur du raisonnement tient en une phrase : une modification provisoire ne saurait servir d’assiette à un impôt fondé sur la valeur locative. Pour la formation de jugement, la différence de traitement entre un immeuble en chantier et un immeuble définitivement transformé repose sur un critère objectif lié à la finalité même de la taxe foncière. Les juges rappellent que la révision ne peut intervenir qu’après la stabilisation des surfaces, des volumes et des usages. Tant que la poussière vole, l’administration doit conserver la valeur antérieure, sauf destruction totale ouvrant droit à l’exonération prévue à l’article 1389.
La société Pamier soutenait que l’état de ses entrepôts, ouverts aux quatre vents, les rendait impropres à toute utilisation et rompait l’égalité devant l’impôt. Elle invoquait également une atteinte disproportionnée à ses capacités contributives au regard du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Aucune de ces thèses n’a convaincu. Le Conseil d’État souligne que l’objectif de neutralité fiscale pendant la phase transitoire justifie l’écart de traitement, sans méconnaître les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789. La question prioritaire de constitutionnalité ne présentait donc pas de caractère sérieux et n’a pas été transmise au Conseil constitutionnel.
Pour les propriétaires, cette décision impose une vigilance accrue sur la chronologie des opérations. Avant la réception et la mise hors d’eau hors d’air, aucune déclaration n’est requise au titre de l’article 1406 du CGI, aucune révision n’est possible, et les exonérations de construction nouvelle ne courent pas. Il devient stratégique de caler la date d’achèvement après le premier janvier lorsque le planning le permet, afin de repousser d’un an l’effet financier. Une fois la rénovation finalisée, si la nouvelle valeur locative bondit de plus de trente pour cent, le lissage triennal prévu à l’article 1518 B demeure l’outil principal pour étaler l’impact. Encore faut-il anticiper ce seuil par un audit locatif, dès la signature de la promesse de travaux, afin de mesurer l’écart futur entre l’ancienne base et la base recalculée.
En cas de contestation, la charge de la preuve repose intégralement sur le contribuable. Un constat d’huissier daté, un rapport de maîtrise d’œuvre détaillant les éléments livrés, des photographies géolocalisées et l’attestation dommages-ouvrage prouvant l’absence de réception constituent l’ossature d’un dossier solide. La réclamation doit être introduite avant le trente et un décembre de l’année qui suit la mise en recouvrement, faute de quoi la porte se referme. L’arrêt Pamier rappelle ainsi qu’entre la première démolition et la remise des clés, la fiscalité reste calée sur la valeur historique. Une fois les rubans coupés, la mécanique cadastrale se remettra en marche, mais pas avant.