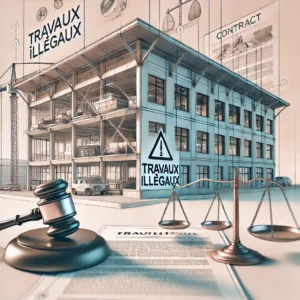Le potin de la semaine
Il y a toujours cette fameuse demande d’expertise “urgente”, celle qui était pour hier. On réorganise le planning, on traite le dossier en priorité, on met tout en œuvre pour rendre dans les temps… et l’on découvre que le mail ne sera finalement ouvert qu’une semaine plus tard. Avec l’expérience, on apprend donc à trier les urgences réelles de celles qui le sont beaucoup moins, afin de gérer nos missions avec efficacité et sérénité.
Et puis, parfois, il y a les vraies urgences : comme ce dossier de perte d’exploitation que nous avons réussi à intégrer en dernière minute, alors même qu’il a demandé un temps important d’analyse, de compréhension, d’échanges et un déplacement sur site. L’évaluation d’un préjudice financier exige une prudence méthodologique constante : comprendre le dommage dans son contexte, reconstituer la situation “avec” et “sans” dommage, vérifier le lien de causalité, distinguer ce qui relève du manque à gagner, de la perte subie ou de la perte de chance, et exprimer l’ensemble en un différentiel économique cohérent. Ce travail n’est jamais une simple compilation, mais un exercice de reconstruction, de cohérence et de méthode.
Comme chez le dentiste, nous gardons toujours un peu de souplesse dans nos plannings pour pouvoir répondre présent lorsqu’un dossier particulier l’exige. Oui, nous parvenons encore à glisser une évaluation ou deux, voire à traiter une expertise issue d’un référé d’ heure à heure. C’est l’avantage de s’appuyer sur un réseau solide, composé d’experts répartis sur toute la France, capables d’intervenir avec réactivité lorsque la situation le nécessite.
Mais il faut le rappeler : l’urgence a un prix. Une bonne expertise ne se fait pas à la hâte. L’anticipation n’est pas un confort, c’est une garantie de qualité. Même si, dans la pratique, nous faisons toujours de notre mieux pour répondre dans des délais serrés, la rigueur impose de rappeler que la qualité dépend d’abord de la préparation.
Droit de préférence du locataire commercial : la Cour de cassation élargit l’exception de la cession globale en copropriété
Le droit de préférence du locataire commercial ne cesse d’alimenter les discussions entre praticiens. La Cour de cassation vient de lui apporter une nouvelle nuance qui mérite d’être connue de tous ceux qui manipulent ventes d’immeubles et baux commerciaux. L’arrêt du 6 novembre 2025 (n° 23-21.442) précise que l’exception tenant à la « cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux » ne se limite pas à un immeuble d’un seul tenant. Elle s’applique aussi à la vente en bloc de plusieurs lots de copropriété, dès lors que le local loué n’en forme qu’une partie. Il suffit qu’un seul lot ne soit pas compris dans le bail, même un réduit à charbon, pour que le droit de préférence tombe.
Les faits montrent bien la difficulté. En 2019, une SCI acquiert plusieurs lots dans une copropriété : certains loués à un premier locataire commercial, d’autres loués à une autre société, et un lot non loué. Le locataire du premier ensemble, une agence immobilière, estime que la vente viole l’article L. 145-46-1 du code de commerce, faute d’avoir respecté son droit de préférence. Selon elle, l’acte notarié avait artificiellement réuni deux ventes distinctes, portant sur des biens appartenant à des propriétaires différents, uniquement pour contourner un droit pourtant d’ordre public. Elle assigne donc vendeurs, acquéreur et notaire pour obtenir l’annulation de la vente.
La cour d’appel lui donne tort en retenant qu’il s’agissait d’une cession unique de locaux commerciaux distincts, exception prévue par le texte. La Cour de cassation corrige immédiatement cette lecture : on ne peut pas parler de cession unique de locaux distincts lorsque les biens vendus n’appartiennent pas au même propriétaire. L’unicité de l’acte n’emporte pas unicité juridique. Sur ce point, la locataire avait raison.
Mais la Cour ne s’arrête pas là. Elle substitue un autre motif, déterminant. Depuis deux arrêts du 19 juin 2025, elle juge que le locataire n’a pas droit à la préemption lorsque le local loué ne constitue qu’une partie de l’immeuble vendu. Cette règle vaut aussi en copropriété. Dans l’affaire présente, la vente ne portait pas uniquement sur les lots loués à la locataire : elle incluait aussi le lot n° 1, un réduit non compris dans le bail. Cette simple présence suffit à qualifier la vente de cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux, exception prévue à l’article L. 145-46-1. Le droit de préférence ne s’appliquait donc pas. Le pourvoi est rejeté.
Pour les transactions, la décision est importante. Elle confirme que l’exception de cession globale n’exige pas un bâtiment entier. Il suffit que l’ensemble vendu comporte un lot accessoire non loué au locataire qui revendique la préemption. Qu’il s’agisse d’une réserve, d’une cave, d’un local technique ou d’un modeste réduit, peu importe : dès lors qu’il ne figure pas dans le bail, la vente échappe au mécanisme de préemption. Une souplesse bienvenue pour sécuriser les ventes, éviter des remises en cause lourdes et réduire le risque contentieux en cas de cession groupée de lots.
L’avocat du diable rappellera toutefois que cette solution n’a rien d’un blanc-seing. La Cour n’a pas fermé la porte à la fraude. Si un vendeur ajoute artificiellement un lot sans consistance pour échapper au droit du locataire, la manœuvre pourrait être sanctionnée. Reste à savoir comment les juges apprécieront la réalité du lot accessoire. À partir de quand un local est-il suffisamment autonome pour être considéré comme partie de l’immeuble. Un volume vide suffit-il. Un local condamné. Une cave commune transformée en lot privatif. La frontière n’est pas tracée et les dossiers futurs viendront sans doute préciser la notion.
Une autre question demeure : jusqu’où cette jurisprudence peut-elle s’étendre. Les ensembles immobiliers fragmentés entre parkings, boxes, caves, couloirs et anciens locaux techniques pourraient-ils tous entrer dans la catégorie des cessions globales, neutralisant presque systématiquement le droit de préférence. Les praticiens savent que certains vendeurs n’attendaient qu’un signal pour regrouper des lots hétérogènes dans un même acte et éviter l’étape, parfois lourde, de l’offre préalable au locataire. Le juge acceptera-t-il toujours cette logique. Ou finira-t-il par réintroduire une exigence de cohérence économique de l’immeuble cédé.
L’intérêt de l’arrêt réside dans son pragmatisme. Le droit de préférence n’a jamais eu vocation à entraver les ventes d’immeubles entiers ou d’ensembles cohérents. Il protège le locataire contre la vente isolée de son local, pas contre les opérations patrimoniales qui dépassent son périmètre. Cette distinction, intuitive sur le papier, devient délicate en copropriété. En affirmant que l’ajout d’un seul lot non loué suffit à faire basculer la vente dans l’exception, la Cour clarifie, mais elle ouvre aussi des marges qui demanderont vigilance.
Pour les professionnels, le message est double. D’un côté, la pratique se trouve facilitée : dès qu’un lot non loué est inclus dans la cession, le droit de préemption ne s’applique pas. De l’autre, il faudra veiller à la sincérité de l’opération. Une analyse trop mécanique pourrait être rattrapée par l’ombre portée de la fraude, argument que le juge n’hésitera pas à mobiliser en cas de montage artificiel.
Clause résolutoire en bail commercial : la loi Pinel s’applique aux instances en cours et peut rendre la clause réputée non écrite
Le contentieux des clauses résolutoires en bail commercial continue de révéler ses pièges, surtout lorsqu’il s’agit d’articuler un commandement délivré avant la loi Pinel et une instance engagée après son entrée en vigueur. La Cour de cassation vient rappeler que la loi du 18 juin 2014, pourtant adoptée depuis plus d’une décennie, continue de produire des effets très concrets sur les baux plus anciens. Lorsqu’une instance est en cours pour faire constater l’acquisition d’une clause résolutoire dont la validité est discutée, la loi nouvelle doit s’appliquer, dès lors que les effets du commandement ne sont pas définitivement réalisés. Et si la clause prévoit un délai inférieur au délai légal d’un mois, elle doit être réputée non écrite.
L’affaire est classique dans sa structure. En juillet 2013, des bailleurs délivrent à leur locataire commercial une sommation d’avoir à remettre les lieux en état. Le commandement vise la clause résolutoire du bail, laquelle prévoit un délai de quinze jours. Problème : même avant la loi Pinel, l’article L. 145-41 du code de commerce imposait déjà un délai minimal d’un mois. Le commandement était donc irrégulier. En septembre 2013, les bailleurs refusent le renouvellement du bail sans indemnité d’éviction. Deux ans plus tard, en septembre 2015, la locataire engage une action pour obtenir cette indemnité. Les bailleurs, par voie reconventionnelle, demandent que la clause résolutoire soit jugée acquise depuis le 5 août 2013. La cour d’appel leur donne raison, estimant que la loi Pinel ne s’applique pas, puisque le commandement était antérieur à la réforme.
C’est cette analyse que la Cour de cassation censure. Elle rappelle d’abord le contenu de l’article L. 145-41 : une clause résolutoire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, le commandement devant impérativement mentionner ce délai à peine de nullité. Elle rappelle ensuite l’article L. 145-15 dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 : sont réputées non écrites les clauses ayant pour effet de faire échec à ces dispositions. Enfin, en application de l’article 2 du code civil, la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques non définitivement réalisées.
La Cour combine ces trois éléments. Le commandement, bien qu’antérieur à la loi Pinel, n’a pas produit ses effets de manière définitive puisque la question de la résiliation faisait encore l’objet d’une instance introduite après l’entrée en vigueur de la loi. Les effets de la clause résolutoire n’étaient donc pas « consommés ». Sa validité devait être appréciée au regard de l’article L. 145-15 dans sa version nouvelle. Or la clause prévoyant un délai de quinze jours portait atteinte à la protection légale du locataire. Elle devait être réputée non écrite. La cour d’appel aurait dû écarter la clause et refuser la résiliation de plein droit.
La haute juridiction casse donc l’arrêt, en ce qu’il avait constaté la résiliation, condamné la locataire à une indemnité d’occupation pendant six années et rejeté ses demandes indemnitaires, notamment l’indemnité d’éviction. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.
Ce rappel est d’une portée pratique considérable. Beaucoup de baux conclus avant la loi Pinel contiennent encore des clauses résolutoires prévoyant des délais insuffisants, parfois hérités de modèles anciens ou de pratiques notariales où le délai de quinze jours faisait figure de standard. Lorsque ces clauses sont invoquées dans une instance postérieure à 2014, elles tombent d’elles-mêmes. Une clause réputée non écrite est anéantie rétroactivement : elle cesse d’exister, ne peut pas être confirmée et ne peut plus être invoquée. Le bailleur se retrouve alors dans la situation délicate de devoir prouver une résiliation judiciaire, ce qui n’est pas la même bataille.
L’avocat du diable constatera que cette solution bouscule aussi une croyance largement répandue chez certains bailleurs, selon laquelle la résiliation de plein droit serait acquise dès l’expiration du délai du commandement, même irrégulier. La Cour rappelle que la clause résolutoire n’est jamais automatique : son acquisition suppose toujours une vérification judiciaire, sauf reconnaissance expresse du preneur. Tant que le juge n’a pas tranché, les effets ne sont pas définitifs. C’est précisément ce qui permet l’application de la loi nouvelle.
Des zones d’incertitude demeurent. Que se passe-t-il lorsque les parties ont continué à exécuter le bail après un commandement irrégulier. Jusqu’où peut-on aller pour considérer que les effets de la clause n’étaient pas définitivement réalisés. Et comment apprécier les situations hybrides où le bailleur n’invoque la clause que tardivement, parfois plusieurs années après le commandement. L’avenir dira comment les juridictions du fond articuleront la protection légale du locataire avec la temporalité parfois sinueuse des litiges en matière commerciale.