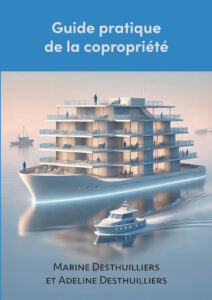Le potin de la semaine
La probité de l’expert : entre indépendance et frustration des parties
L’expert est ce tiers à part : ni juge, ni partie, ni arbitre. Sa mission n’est pas de plaire, mais d’éclairer. Pourtant, dans la pratique, l’attente des parties surtout dans les expertises amiables reste souvent teintée d’un malentendu : elles confondent collaboration et influence. Quand un cabinet refuse d’ajuster ses conclusions après remarques, cela ne traduit pas un manque d’écoute, mais une conception exigeante de la probité.
Le courrier cité résume bien ce malaise : « Je vais donc clôturer le débat et me satisfaire du rapport qui a été envoyé, sans avoir eu l’opportunité de le challenger. (…) Vous êtes le seul cabinet à ne pas prendre en compte l’abattement de taxe foncière dans votre rapport. Vous êtes également les seuls à nous envoyer un rapport définitif dès le premier envoi, sans nous laisser l’opportunité de l’améliorer. » Derrière cette remarque polie, on perçoit l’agacement d’un interlocuteur privé d’un levier d’influence, face à un expert qui assume sa neutralité et son indépendance.
Le cœur de la question n’est pas technique abattement de taxe foncière ou non mais éthique. L’expert judiciaire comme l’expert indépendant est lié par un principe fondamental : la probité, c’est-à-dire l’honnêteté intellectuelle et la fidélité à la vérité des faits. Ce principe impose deux exigences : l’indépendance de jugement et la transparence méthodologique. L’expert n’a pas à rechercher un consensus artificiel. Il doit écouter, analyser, mais refuser tout compromis contraire à la rigueur de sa mission. Le contradictoire n’est pas une négociation : c’est un processus d’éclairage.
Lorsque la discussion contradictoire devient un marchandage ou une tentative de réécriture du rapport, elle trahit sa finalité. Le rapport d’expertise n’est pas un document à valider par les parties ; c’est une opinion motivée, fondée sur des constatations, des analyses et des comparaisons vérifiables. Il engage la responsabilité de l’expert, non celle de ceux qu’il éclaire. La probité consiste à ne rien concéder à la complaisance. Cela suppose parfois d’être perçu comme “rigide”, mais c’est précisément ce refus de la souplesse opportuniste qui fonde la crédibilité d’un expert.
L’objection technique mentionnée l’abattement de taxe foncière illustre d’ailleurs bien le dilemme. Cet abattement peut être légitime dans certaines méthodes de valorisation, mais pas dans d’autres. Si l’expert estime, en conscience, qu’il n’a pas lieu d’être appliqué parce qu’il ne correspond pas à la pratique du marché ou à la nature du bien, il a le devoir de maintenir sa position. Céder à la demande d’une partie sous prétexte “d’harmoniser” reviendrait à compromettre son indépendance. L’indépendance n’est pas une option méthodologique : c’est une obligation déontologique.
Dans le cas présent, l’ensemble des loyers comparables analysés stipulent que la taxe foncière est à la charge du locataire. Autrement dit, cette charge, loin d’être exorbitante, correspond à l’usage du marché. Appliquer un abattement supplémentaire reviendrait à minorer artificiellement la valeur locative. Un expert ne peut ni modifier ni orienter artificiellement une valeur locative. La valeur retenue découle des références comparables, toutes établies sur la base de loyers comportant cette clause. À cet égard, la demande formulée par le client « De plus, pouvez-vous également enlever les notions de taxe foncière sur le tableau de références ? » ne pouvait être acceptée. Retirer ces mentions reviendrait à effacer une caractéristique objective des baux étudiés et à altérer la transparence de la méthode. Ce serait contraire à l’exigence d’exhaustivité et d’impartialité qui fonde la valeur probante du rapport.
La méthodologie rappelée dans la Lettre M² de février 2025 précise qu’en cas d’application d’un abattement pour charges exorbitantes, il convient d’abord d’effectuer une majoration préalable des loyers de comparaison supportant les mêmes charges, afin de maintenir un périmètre constant. L’article R145-7 du Code de commerce autorise de tels correctifs. Sans ce retraitement, un abattement isolé créerait une distorsion économique entre les références et le bien expertisé.
Dans le présent dossier, les comparables proviennent exclusivement de baux supportant également la taxe foncière. Conformément à cette méthodologie et à la jurisprudence récente, la valeur locative de marché ne justifie donc pas l’application d’un abattement supplémentaire, faute de retraitement préalable.
Pour autant, la probité ne s’oppose pas à la pédagogie. L’expert doit expliquer pourquoi il retient ou non certains paramètres, justifier sa méthode et permettre la compréhension de ses choix. Le contradictoire n’exige pas la concession, mais la clarté. Trop souvent, les tensions naissent d’un déficit d’explication : l’expert pense “technique”, là où son interlocuteur pense “intérêt”.
Quant au caractère “définitif” du rapport, il n’exprime pas une fermeture au dialogue, mais la rigueur du processus. L’expert doit entendre, examiner et, s’il y a lieu ou non d’intégrer les observations. Mais une fois signé, le rapport engage sa responsabilité professionnelle et ne peut être modifié sans compromettre le principe d’impartialité. Les échanges doivent donc se tenir avant la clôture, dans le respect du contradictoire, sans confusion entre participation et influence.
Être un expert probe, c’est accepter d’être parfois mal compris. C’est maintenir une position quand elle est fondée, même si elle déplaît. C’est distinguer deux moments : celui de l’échange, ouvert, et celui de la conclusion, ferme. À la fin, l’expert n’écrit ni pour plaire ni pour satisfaire, mais pour être compris et pouvoir défendre, en droit et en conscience, chaque ligne de son rapport.
Pendant longtemps, le déplafonnement du loyer commercial a reposé sur une équation apparemment simple : le loyer reste plafonné, sauf si le bailleur démontre que l’environnement du local a changé au point d’avoir favorablement influencé l’activité du preneur. L’article L.145-33 du Code de commerce en donne la base : le loyer du bail renouvelé est fixé d’après la valeur locative, compte tenu « notamment des facteurs locaux de commercialité ». L’article L.145-34 précise la règle du plafonnement, et la jurisprudence a posé une condition ferme : seule une modification matérielle, objective, durable et postérieure à la prise d’effet du bail précédent peut justifier un déplafonnement.
Dans les faits, les tribunaux n’ont jamais transigé : la modification devait être démontrée et avoir produit un effet positif sur l’activité commerciale exercée dans les lieux. La Cour de cassation rappelait régulièrement que l’évolution devait résulter de transformations significatives du tissu commercial ouverture d’une voie nouvelle, implantation d’un centre commercial, arrivée d’une clientèle nouvelle et qu’une simple amélioration esthétique, ou un dynamisme général du quartier, ne suffisait pas (Cass. 3e civ., 30 nov. 1994, n° 92-19.818 ; Cass. 3e civ., 10 févr. 2010, n° 09-10.104 ; Cass. 3e civ., 26 janv. 2017, n° 15-25.887).
Ce cadre, protecteur pour le locataire, exigeait des preuves solides. Dans la pratique, la plupart des demandes de déplafonnement échouaient faute de démontrer un lien causal concret entre la transformation du quartier et l’activité exploitée. Les bailleurs évoquaient volontiers la « requalification urbaine », les « aménagements récents » ou la « hausse de fréquentation », mais sans données chiffrées, ces affirmations restaient théoriques. Or, un trottoir élargi ou un mobilier urbain flambant neuf ne créent pas une clientèle nouvelle. Le juge exigeait des éléments objectifs : étude de flux piétonniers, évolution des loyers comparables, statistiques de vacance, ou chiffre d’affaires du preneur.
Dans le dossier étudié, les arguments de déplafonnement reposaient précisément sur ce type d’éléments généraux : la zone avait été embellie, de nouveaux équipements publics avaient vu le jour, et la fréquentation semblait en hausse. Mais rien n’était quantifié. Aucune étude, aucun indicateur économique, aucune évolution mesurable des performances du commerce exploité. En outre, la nature de l’activité prestations techniques et transactions immobilières n’était pas corrélée à la fréquentation piétonne ni au tourisme local. Résultat : pas de modification notable des facteurs locaux de commercialité au sens de la loi, et donc maintien du loyer dans le cadre du plafonnement (Cass. 3e civ., 25 janv. 2018, n° 16-26.409).
Ce schéma, bien établi depuis des décennies, vient pourtant de basculer. Dans un arrêt du 18 septembre 2025 (Cass. 3e civ., n° 24-13.288, publié au Bulletin), la Cour de cassation adopte une lecture nouvelle du texte. Elle juge désormais que la modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement si elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité du locataire, indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité. Autrement dit, la preuve d’un effet concret sur les résultats du preneur n’est plus nécessaire : il suffit que la modification soit objectivement susceptible d’améliorer ses conditions d’exploitation.
Ce changement sémantique marque une inflexion profonde. On passe d’une logique de résultat à une logique de potentialité. Le juge n’attend plus que le changement ait porté ses fruits pour l’admettre. Il lui suffit qu’il soit de nature à le faire. En d’autres termes, la promesse compte autant que l’effet.
Cette décision, rendue en formation de section, et publiée au Bulletin, ne doit rien au hasard. Elle traduit la volonté de la Cour de cassation d’adapter le droit du bail commercial à la réalité des territoires. Les villes se transforment vite : piétonnisation des centres, reconversion de friches, création de zones mixtes. Les effets économiques de ces mutations se manifestent parfois plusieurs années après les travaux. Attendre la preuve d’un impact comptable reviendrait à ignorer ces dynamiques urbaines. En autorisant le juge à se fonder sur la seule potentialité d’un effet favorable, la Cour reconnaît la valeur anticipée de ces transformations.
Mais cette souplesse n’est pas sans conséquence. D’un côté, elle offre au bailleur une marge d’argumentation plus large : il lui suffit de prouver que le contexte général s’est amélioré, même sans démonstration d’un effet concret. De l’autre, elle fragilise la prévisibilité du preneur, qui ne peut plus s’appuyer sur la seule stabilité de son chiffre d’affaires pour maintenir le plafonnement. La notion même de « commercialité » devient plus abstraite, moins mesurable.
Dans cette nouvelle lecture, le rôle de l’expert devient central. Il ne s’agit plus seulement de vérifier si le changement a produit un effet, mais d’apprécier s’il est objectivement de nature à en produire un. Ce n’est plus une mission de comptable, mais d’analyste du territoire. L’expert doit évaluer la cohérence entre la mutation urbaine, la typologie du commerce et la clientèle visée. Il devra croiser des données économiques (flux, fréquentation, vacance), mais aussi qualitatives : attractivité du quartier, accessibilité, image du site, repositionnement de la zone. Il devra également s’interroger sur la compatibilité de l’activité exploitée avec cette évolution.
L’arrêt du 18 septembre 2025 n’autorise pas un déplafonnement automatique dès qu’une transformation est visible. Il impose au contraire une analyse fine du lien entre l’évolution du contexte et l’exploitation exercée. Une piétonnisation peut être favorable à un glacier, mais pas forcément à un garage. Un centre culturel peut dynamiser une librairie, sans effet pour un entrepôt logistique. Le juge conserve la clé de l’interprétation, mais l’expert en détient la matière.
Sur le plan théorique, cette évolution rapproche le droit du bail commercial d’une logique de marché : la valeur locative devient l’expression d’un potentiel économique et non plus la photographie du passé. Sur le plan pratique, elle ouvre une zone d’incertitude : comment distinguer le changement prometteur du simple embellissement ? Quelle part d’anticipation l’expert peut-il raisonnablement intégrer sans verser dans la spéculation ?
La jurisprudence française a connu une évolution graduelle mais structurée :
- 1994 à 2017 :période de stabilité et de prudence. La commercialité se juge sur des faits mesurables, et le déplafonnement demeure l’exception.
- 2018 :renforcement du lien de causalité économique. Le juge exige que le changement ait un effet concret sur l’activité du locataire.
- 2024 – 2025 :inflexion nette. La Cour reconnaît désormais la valeur anticipée du potentiel commercial, même non encore matérialisé.
Conséquences pratiques pour l’expertise
- Charge de la preuve assouplie pour le bailleur : il n’a plus à démontrer un effet mesurable, mais à caractériser une mutation du contexte local favorable à l’exploitation.
- Rôle accru de l’expert : il doit évaluer non seulement les faits passés (données chiffrées, fréquentation), mais aussi la cohérence prospective entre les mutations urbaines et la nature du commerce.
- Méthodologie renforcée : nécessité d’appuyer l’analyse sur des sources objectives (INSEE, DVF, flux piétonniers, urbanisme commercial, taux de vacance).
- Risque accru d’incertitude juridique : la frontière entre amélioration qualitative et transformation notable devient floue, ouvrant la voie à des contentieux d’interprétation.
Le juge regarde désormais l’avenir du quartier autant que son passé, et l’expert devient le traducteur de cette vision : à lui d’articuler, avec rigueur et prudence, la ligne de crête entre potentialité et spéculation.