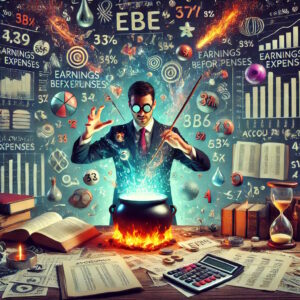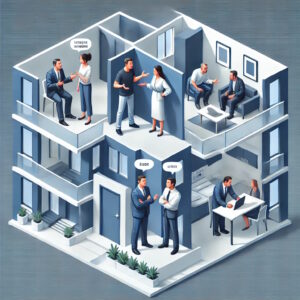Le potin de la semaine
Comportement à adopter face à un expert judiciaire
On mésestime trop souvent l’influence du comportement des parties dans une procédure. Pourtant, l’attitude compte presque autant que les arguments. Commençons par enfoncer une porte ouverte : l’expert judiciaire est le bras du juge. Sa mission est simple à énoncer : voir, entendre, analyser à la place du juge, sur un point précis du litige. Oui, le juge ne sait pas tout. Et c’est justement sa sagesse : il délègue à des personnes d’expérience ce qu’il ne maîtrise pas.
Dès lors, il faut bien comprendre une chose : face à l’expert, on n’est pas en présence d’un « technicien extérieur », mais de l’incarnation temporaire du juge. Posez-vous la question : oseriez-vous dire à un magistrat « asseyez-vous là » ou « laissez-moi parler, je sais mieux que vous » ? Non ? Alors pourquoi certains se permettent ce comportement vis-à-vis d’un expert ?
Certes, le juge n’est pas juridiquement lié par le rapport d’expertise. Mais soyons sérieux : s’il a pris soin de désigner un expert, ce n’est pas pour l’anecdote. Dans la pratique, le rapport pèse lourd. Et un comportement déplacé en expertise revient à froisser l’oreille de celui qui tient la plume avant la décision.
Hier encore, j’étais en expertise judiciaire. Une partie a décidé de cocher toutes les mauvaises cases. Première idée brillante : proposer que la réunion se tienne dans son propre bureau. Et mieux encore : m’installer à sa table, entre les avocats, pendant qu’il s’asseyait en face de moi. Premier recadrage : un expert aime voir toutes les parties et déteste avoir quelqu’un dans son dos qui surveille ses notes. Rien que ça, c’est déjà une règle élémentaire.
Deuxième erreur : quand je lui ai donné la parole, il s’est lancé dans une leçon sur les comparables que je devrais utiliser. Après deux minutes de comparaison de choux avec et des carottes, j’ai voulu l’interrompre. Réponse : « Ne me coupez pas, laissez-moi parler. » Très bien, deux minutes supplémentaires pour ses carabistouilles, puis rappel des règles de bienséance. Pendant ce temps, son avocat s’enfonçait dans sa chaise, dépité. Et il y avait de quoi : quelques instants plus tôt, son propre client nous avait expliqué que son bureau servait à recevoir les clients pour signer des contrats commerciaux. Celui-là même qui était entrain de nous expliquer qu’il ne s’agissait pas d’un local « commercial » mais uniquement d’un bureau. Un coup de pied dans la fourmilière et, en prime, une balle dans le pied.
Le conseil aux avocats est donc clair : préparez vos clients. Un expert judiciaire n’est pas un contradicteur à dominer, ni un arbitre à séduire, mais l’auxiliaire du juge. Respect, courtoisie et écoute sont vos meilleurs alliés. Laisser parler ne veut pas dire monopoliser. Expliquer ne veut pas dire imposer. Et contredire n’est utile que si l’on a des arguments solides. Tout le reste se retourne contre celui qui croit marquer des points.
Le juste équilibre se trouve entre la participation active et le respect du rôle de chacun. Les meilleures expertises sont celles où chacun expose ses arguments, sans chercher à donner des ordres ni à jouer au professeur. L’avocat qui prépare son client à ce jeu d’équilibre lui évite bien des déconvenues.
Bail rural et cogestion entre époux : quand la gestion d’affaires s’invite dans le débat
Le 18 septembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui mérite l’attention des praticiens du droit rural et du droit des régimes matrimoniaux. La décision (n° 419 FS-B, pourvoi n° 23-15.971) pose une question redoutable : peut-on valider un bail rural conclu par un seul époux sur un bien commun, sans l’accord de l’autre, en invoquant les règles de la gestion d’affaires ? La question n’est pas seulement théorique : elle met en jeu la sécurité des transactions, la protection des conjoints et l’équilibre délicat entre la stabilité des baux ruraux et la rigueur du droit des biens communs.
Les faits sont d’une simplicité trompeuse. En 2016, un mari consent verbalement un bail rural à une voisine sur des terres dépendant de la communauté. Deux ans plus tard, lui et son épouse vendent les parcelles à un couple tiers. La preneuse, informée, revendique son droit de préemption, comme la loi lui en donne la possibilité. Elle saisit alors le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire reconnaître la validité de son bail et exercer son droit. En défense, l’épouse conteste l’existence même du bail : elle n’a jamais donné son accord, et l’article 1425 du Code civil impose que les époux consentent ensemble aux actes de disposition portant sur des biens communs, ce qui inclut la conclusion d’un bail rural. L’article 1427 prévoit même la nullité de l’acte conclu sans le consentement du conjoint. Sur ce terrain, la défense semblait solide : bail rural conclu par un seul époux, nullité à la demande de l’autre.
Pourtant, le tribunal de Lisieux puis la cour d’appel de Caen valident le bail. Leur raisonnement : le mari avait agi dans le cadre de la gestion d’affaires au sens de l’article 219, alinéa 2 du Code civil. Autrement dit, il aurait géré une affaire commune sans mandat, mais au bénéfice de la communauté, et son acte pouvait donc être couvert. Le mécanisme de la gestion d’affaires, conçu pour valider certaines initiatives prises sans mandat mais dans l’intérêt d’autrui, venait ainsi s’inviter dans le champ du bail rural.
La Cour de cassation casse partiellement. Elle admet, dans la lignée d’un arrêt du 2001, que la gestion d’affaires peut en principe s’appliquer à un bail rural conclu par un seul époux. Mais elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la gestion avait été « utile », condition essentielle de ce mécanisme. En matière de gestion d’affaires, il ne suffit pas que quelqu’un agisse sans mandat : il faut encore que son intervention ait été utile au géré, en l’occurrence à la communauté. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Rouen.
La portée de l’arrêt est considérable. D’abord, il ouvre la porte : la gestion d’affaires peut servir de correctif à l’absence de cogestion dans un bail rural. Ce n’est pas rien. Le bail rural est un acte de disposition majeur : il engage le bien pour neuf ans au minimum, il confère un droit au preneur, il réduit la valeur de revente et limite la liberté de jouissance. Le Code civil a toujours exigé le double consentement pour de tels actes, précisément pour protéger le conjoint. Permettre que la gestion d’affaires vienne suppléer ce défaut, c’est fragiliser le principe même de cogestion.
Ensuite, il introduit un critère incertain : l’utilité. Qu’est-ce qu’une gestion utile ? Est-ce celle qui rapporte un fermage régulier à la communauté ? Celle qui évite que la terre reste en friche ? Celle qui entretient la valeur patrimoniale du bien ? Ou bien faut-il une utilité objectivement démontrée par le juge ? L’ambiguïté est grande. L’utilité peut être appréciée de manière subjective (le conjoint trouve que c’était bénéfique) ou objective (le juge constate que cela l’était). Ce flou laisse un espace de contestation permanent.
Historiquement, la gestion d’affaires a toujours été conçue comme un mécanisme de rattrapage : quand une personne prend l’initiative de gérer l’affaire d’autrui sans mandat, on valide son acte si c’était utile et si cela a profité à autrui. Appliqué aux biens communs, cela revient à dire qu’un époux peut, sans autorisation, conclure un bail, et que ce bail sera validé si le juge considère que c’était profitable à la communauté. Or, le régime de communauté est fondé sur la cogestion : l’article 1425 exige le double accord pour donner à bail un fonds rural, précisément pour éviter que l’un engage le bien à l’insu de l’autre. Le recours à la gestion d’affaires brouille les cartes.
La Cour de cassation ne tranche pas ce débat de principe. Elle se contente de dire : la gestion d’affaires est possible, mais il faut vérifier l’utilité. En apparence, c’est une position équilibrée. En réalité, c’est une boîte de Pandore. Car l’utilité est un critère souple, malléable, que chaque juge du fond interprétera différemment. Un fermage annuel sera-t-il jugé suffisant ? Ou faudra-t-il prouver que la terre aurait perdu de la valeur sans bail ? Le critère laisse place à l’aléa judiciaire.
Concrètement, les notaires et avocats devront redoubler de prudence. Le bail rural conclu par un seul époux n’est pas automatiquement nul. Il peut être validé si le juge estime que la gestion était utile. Mais l’incertitude demeure. Pour sécuriser les opérations, la solution reste la même : obtenir la cogestion expresse des deux époux, ou à défaut, solliciter une habilitation judiciaire. Tout autre montage laisse planer une menace contentieuse.
Comparons avec d’autres domaines. Pour les baux commerciaux, la cogestion n’est pas exigée de la même manière. Pour les actes de disposition ordinaires, un époux peut agir seul. La sévérité particulière du bail rural s’explique par sa durée et ses conséquences patrimoniales. Introduire un correctif par la gestion d’affaires, c’est rapprocher le bail rural des autres contrats, au détriment de la spécificité voulue par le législateur. Est-ce souhaitable ?
L’arrêt du 18 septembre 2025 est à la fois rassurant et inquiétant. Rassurant pour les preneurs, qui voient leur bail sauvé malgré les vices de forme. Inquiétant pour les conjoints, qui voient leur protection relativisée. La Cour n’a pas tranché le débat, elle l’a relancé. La sécurité juridique en sort affaiblie : il faudra désormais plaider l’utilité dans chaque litige.
Déclarer une activité accessoire : la leçon de l’arrêt du 18 septembre 2025 (Civ. 2e, n° 23-21.201)
L’arrêt rendu le 18 septembre 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n° 23-21.201, publié au Bulletin) marque une nouvelle étape dans la jurisprudence relative aux obligations de déclaration de l’assuré. Derrière l’incendie d’un entrepôt et le refus d’indemnisation par une compagnie d’assurance se cache une question essentielle : jusqu’où va l’obligation de transparence de l’assuré ? Et surtout, cette obligation dépend-elle du lien entre la circonstance omise et le sinistre ? La Cour répond avec fermeté : non, il n’y a pas de lien exigé. C’est la logique contractuelle, et non la causalité factuelle, qui détermine la validité du contrat.
Le litige oppose la société civile 123 JM, propriétaire d’un entrepôt de 7 500 m², à la société MIC Insurance Company, venant aux droits de Millenium Insurance Company Limited. En décembre 2011, la société 123 JM souscrit une police multirisque professionnelle, déclarant une activité principale de stockage de vêtements. Trois ans plus tard, en février 2014, elle conclut un bail avec la société Distri Clim, qui installe dans une partie des locaux une activité de vente et de stockage de matériel de climatisation. La surface concernée représente environ 5 % de l’ensemble. Le 17 mai 2014, un incendie détruit l’immeuble. L’assuré réclame plus de 1,3 million d’euros de dommages immobiliers, près de 94 000 euros pour les loyers perdus et divers frais annexes. L’assureur refuse, estimant que le contrat est nul pour réticence intentionnelle : l’assuré n’a pas déclaré en cours de contrat cette nouvelle activité, qui, selon lui, modifiait l’appréciation du risque.
Le tribunal de commerce de Bobigny avait partiellement donné raison à l’assuré, en limitant l’indemnisation. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 21 juin 2023, avait au contraire condamné l’assureur à payer l’intégralité des sommes demandées. Son raisonnement : l’activité de Distri Clim n’était qu’accessoire, elle n’avait pas modifié substantiellement le risque et, surtout, il n’était pas établi qu’elle avait joué un rôle dans l’incendie ou dans sa propagation. Autrement dit, sans lien causal, pas de nullité.
La Cour de cassation casse et annule. Elle rappelle que l’article L. 113-2, 3° du Code des assurances impose à l’assuré de déclarer toute circonstance nouvelle de nature à aggraver le risque ou à en créer de nouveaux. Elle rappelle aussi que l’article L. 113-8 sanctionne la réticence intentionnelle par la nullité du contrat, « alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ». L’erreur de la cour d’appel est donc claire : elle a conditionné l’obligation de déclaration à un lien avec le sinistre, ce qui n’est pas prévu par le texte.
Cet arrêt illustre la logique propre au droit des assurances. L’évaluation du risque se fait ex ante, au moment où l’assureur accepte de garantir, et non ex post, à la lumière du sinistre. L’assureur doit pouvoir adapter ses conditions, ajuster sa prime ou refuser la garantie dès qu’une nouvelle activité apparaît, même si elle paraît secondaire. Le fait que l’incendie n’ait pas été causé par les bouteilles de gaz éventuellement présentes dans les locaux de Distri Clim est indifférent. Ce qui compte, c’est que cette activité modifiait, au moins potentiellement, l’appréciation initiale du risque par l’assureur.
Il est utile ici de rappeler le mécanisme général. Lors de la conclusion du contrat, l’article L. 113-2, 2° oblige l’assuré à répondre exactement aux questions posées par l’assureur. Ce questionnaire fixe le cadre de la couverture. Ensuite, en cours de contrat, l’article L. 113-2, 3° impose de déclarer les circonstances nouvelles. Deux régimes s’appliquent en cas de manquement : si la fausse déclaration est intentionnelle, l’article L. 113-8 prévoit la nullité du contrat ; si elle est simplement inexacte, sans mauvaise foi, l’article L. 113-9 prévoit une réduction proportionnelle de l’indemnité. La frontière est donc l’intentionnalité. Dans l’affaire, la société d’assurance plaidait la réticence intentionnelle, alors que l’assuré soutenait avoir agi de bonne foi, estimant que l’activité annexe ne nécessitait pas de déclaration.
La jurisprudence antérieure confirme cette rigueur. On peut citer l’arrêt de la 1re chambre civile du 13 novembre 1996, où un assuré ayant omis de déclarer le stockage de produits inflammables a vu son contrat annulé, même si l’incendie avait une autre cause. De même, un arrêt du 20 février 2001 a validé la nullité d’une police automobile pour omission de déclarer un usage professionnel plus intensif, sans rapport avec l’accident survenu. Dans les deux cas, la Cour a écarté toute exigence de causalité. L’arrêt du 18 septembre 2025 s’inscrit donc dans une continuité : il réaffirme que l’obligation de déclaration est autonome, indépendante du sinistre.
Ce raisonnement a des implications concrètes pour les propriétaires-bailleurs. Chaque nouveau bail doit être analysé non seulement sous l’angle locatif, mais aussi sous l’angle assurantiel. Louer à un nouveau preneur exerçant une activité différente, même sur quelques dizaines de mètres carrés, doit déclencher une notification à l’assureur. Peu importe que l’entrepôt continue d’être majoritairement occupé par des stockeurs de vêtements : le simple fait d’introduire une activité industrielle ou commerciale différente est une circonstance nouvelle. L’assureur doit être informé, par écrit, pour éviter toute contestation ultérieure.
Pour les avocats, la leçon est limpide : conseiller systématiquement aux clients de notifier tout changement de locataire ou d’activité. Trop souvent, la déclaration à l’assureur est vue comme une formalité inutile. Cet arrêt démontre qu’il s’agit d’une condition de survie du contrat. La sanction est radicale : la nullité entraîne la perte de toute indemnisation, même pour des dommages de plusieurs millions d’euros. La réduction proportionnelle prévue par l’article L. 113-9 n’intervient que si l’assuré peut démontrer sa bonne foi. Mais dès que l’assureur parvient à établir une réticence intentionnelle, tout est perdu.
Pour les courtiers, la responsabilité est également lourde. Ce sont eux qui remplissent les questionnaires, posent les questions, et transmettent les informations. En cas de litige, l’assuré n’hésitera pas à se retourner contre eux, en arguant d’un défaut de conseil. Cet arrêt doit donc être lu aussi comme un rappel à la vigilance des intermédiaires : ne pas se contenter de l’activité principale, mais interroger le client sur les activités secondaires, sur les évolutions possibles, et lui rappeler son obligation de déclaration en cours de contrat.
L’arrêt ouvre aussi la voie à plusieurs interrogations. Jusqu’où va l’obligation de déclaration ? Faut-il informer l’assureur de chaque modification minime ? Si un locataire change de produit, par exemple de vêtements à chaussures, est-ce une circonstance nouvelle ? La Cour ne donne pas de réponse précise. Elle se contente de rappeler le principe : toute circonstance susceptible d’aggraver ou de créer un nouveau risque doit être déclarée. En pratique, cela conduit à une obligation large, presque illimitée.
Certains diront que cette rigueur est excessive. La sanction de la nullité est radicale, parfois disproportionnée par rapport à l’omission. On pourrait imaginer une application plus souple, avec une modulation en fonction de la gravité de l’omission. C’est d’ailleurs ce que permet l’article L. 113-9, mais à condition que l’assuré soit de bonne foi. Toute la difficulté est donc de caractériser l’intention. Était-ce une simple négligence ou une volonté de tromper ? Dans l’affaire, la cour d’appel avait privilégié une lecture indulgente, estimant que l’activité accessoire ne nécessitait pas de déclaration. La Cour de cassation lui reproche d’avoir raisonné à partir du sinistre. Le renvoi devant la cour d’appel de Rouen devra trancher cette question d’intentionnalité.
Cet arrêt confirme une orientation constante : l’assurance repose sur la loyauté de l’assuré. La causalité n’a rien à voir avec l’obligation de déclaration. Le message est clair : il faut déclarer, même si l’on pense que c’est accessoire, même si l’on croit que cela ne change rien. La sanction du silence est potentiellement fatale.