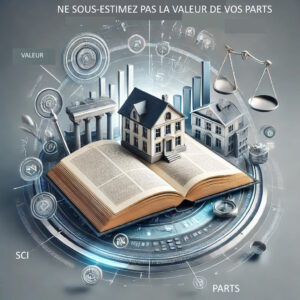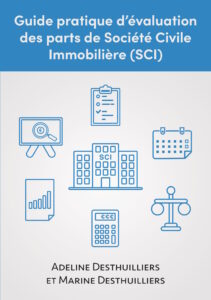Le potin de la semaine
Quand l’expert-comptable oublie la pierre, l’expert immobilier reprend les fondations
Chez ADMA, on aime les moutons à cinq pattes ; celui-ci a l’air d’un agneau mais il cache un bon vieux bélier. Un couple se sépare, un bien immobilier à partager, des travaux financés par la SARL de monsieur : sur le papier, c’est simple. Dans la réalité, c’est un terrain glissant où l’indemnisation claque comme une tuile mal scellée.
Premier réflexe : l’indemnité de reprise. On calcule le profit subsistant, on regarde la vétusté des cloisons, des sanitaires et du sol remis à neuf. Le bailleur, ici madame, touche une somme censée compenser l’enrichissement tiré des investissements du locataire, en l’occurrence la société de monsieur. Problème : ces mêmes aménagements dorment déjà dans le bilan de la SARL. Si l’on verse l’indemnité, la valeur de ses titres grimpe aussitôt, exactement de la différence entre l’indemnité et la valeur nette comptable des immobilisations. Jolie opération qui, au passage, efface le reliquat d’amortissements encore à courir. On paie d’une main, on perd de l’autre : l’art de déplacer la ligne sans rien effacer.
Deuxième piste : la comparaison avant après. On fige la valeur actuelle du bien immobilier comme s’il n’avait jamais connu un coup de marteau, histoire d’éliminer l’effet marché. On la compare à la valeur post-chantier, en retranchant la toiture réglée sur les deniers personnels de madame. La différence donne la quote-part des améliorations payées par la SARL, autant dire la base d’une indemnité. Théoriquement limpide… sauf quand le bilan a laissé filer quelques chevilles. L’expert-comptable a bouclé la valorisation de la société, tout semble calé, mais le diable se cache dans les détails : a-t-il distingué le foncier de l’exploitation ? a-t-il correctement ventilé les immobilisations entre structure et équipement ?
Si la partie immobilière a été traitée comme un simple poste d’actif, sans décotes de marché ni état de vétusté, le différentiel risque de s’effondrer au premier coup d’œil d’un juge. Et soudain, l’indemnité patiemment calculée se transforme en double peine : survalorisation des titres d’un côté, compensation irrecevable de l’autre. Moralité : avant de trancher entre reprise ou avant après, on décortique ligne à ligne le bilan, on recalcule la valeur vénale du bien immobilier et on garde à l’esprit que ce qui a l’air banal cache souvent un sacré roman comptable.
Chez ADMA, on a appris à ne pas opposer les chiffres aux murs. L’expert-comptable sait lire un bilan, évaluer des titres, suivre l’amortissement d’un actif, mais il ne lui appartient pas toujours de dire combien vaut un bien immobilier sur le marché libre. À l’inverse, l’expert immobilier connaît le terrain, la vétusté réelle, les tensions du secteur, mais il ne suffit pas d’estimer un bien pour comprendre ce qu’il représente dans la structure financière d’une société. C’est précisément là que réside notre valeur ajoutée : croiser les regards, relier la technique immobilière aux mécanismes comptables, articuler l’actif physique et l’actif capitalisé. Chez ADMA, la double compétence est intégrée. Pas de cloison étanche entre les chiffres et la pierre, mais un aller-retour constant entre les deux pour que l’expertise rende compte de la réalité dans toute sa complexité.
Bureaux en sommeil, logements en attente : la loi Daubié ouvre la porte à la reconversion
Le Parlement vient d’adopter la loi n° 2025-541, publiée au Journal officiel le 16 juin 2025. Porté par le député Romain Daubié, le texte vise à faciliter la transformation de bureaux vacants (et plus largement de locaux tertiaires) en logements, dans un contexte où les mètres carrés inoccupés s’empilent d’un côté, pendant que la demande de logements, elle, ne décroît pas.
Depuis 2020, le télétravail a durablement modifié les usages. L’immobilier de bureaux, en particulier dans les grandes métropoles, en sort fragilisé. En Île-de-France, l’offre immédiate de bureaux a atteint 5,8 millions de mètres carrés au premier trimestre 2025, soit deux fois plus qu’il y a cinq ans. Et cette vacance ne se limite pas aux tours de La Défense. De nombreuses villes moyennes comptent désormais leurs plateaux vides, souvent dans des immeubles anciens, difficilement reconfigurables sans une intervention lourde.
Face à cela, la transformation en logements reste marginale. À peine 2 000 unités par an en moyenne, selon la Banque de France. Non pas faute d’intérêt, mais faute de cadre. Les freins sont connus : règles d’urbanisme rigides, complexité des destinations dans les PLU, lourdeur des procédures en copropriété, ou encore incertitudes techniques et fiscales.
La loi Daubié tente de dénouer tout cela. Elle permet aux maires et présidents d’intercommunalité de déroger ponctuellement aux règles du PLU sur les changements de destination, dès lors qu’il s’agit de reconvertir des locaux tertiaires. Elle élargit le champ à tous types de bâtiments : bureaux, anciennes trésoreries, hôtels, cités administratives, locaux commerciaux ou agricoles désaffectés. Elle confie aussi à l’Agence nationale de la cohésion des territoires un rôle actif d’assistance aux collectivités, tant pour recenser les gisements fonciers que pour évaluer leur potentiel de transformation.
Elle intègre par ailleurs plusieurs ajustements techniques : recours facilité au permis de construire à destinations successives, possibilité de financer des équipements publics via des conventions de projet urbain partenarial, marchés de conception-réalisation pour le logement étudiant, et allègement des règles de vote en copropriété mixte (la majorité simple suffit désormais pour décider d’une transformation et adapter la répartition des charges).
Côté expertise, ce nouveau cadre change plusieurs choses. D’abord, il impose de reconsidérer la valeur vénale des actifs vacants à la lumière de leur potentiel de transformation. Un bureau vide dans un marché saturé ne se valorise pas comme un foncier obsolète, surtout si le PLU devient plus souple. Ensuite, il complexifie l’analyse : il faut désormais intégrer la faisabilité de la reconversion, le coût des travaux de mise aux normes, les risques liés à la structure du bâtiment, mais aussi les effets d’un changement d’usage sur les charges de copropriété, les servitudes ou les équilibres locatifs. Enfin, il soulève des questions fiscales : quid de la TVA sur travaux, de l’impact sur la taxe foncière, de la requalification du bien dans les bilans d’actifs, ou encore de la compatibilité avec les baux en cours.
Autant d’éléments qui nécessitent une approche croisée, à la fois juridique, technique, urbanistique et financière. Chez ADMA, ce type de dossier n’est jamais traité en silo. Car une valeur, ce n’est pas juste une fourchette ou un prix moyen au mètre carré. C’est une projection argumentée, qui prend en compte la situation réelle du bien, son environnement juridique, ses potentialités et ses contraintes.
La loi Daubié ne fait pas tout, mais elle ouvre une porte. Aux collectivités d’en faire un outil, aux porteurs de projet d’en mesurer l’opportunité, et aux experts de poser les bonnes questions. Car entre un plateau vide et un logement occupé, il y a plus qu’un changement de destination : il y a une évaluation à construire.
Loyer net de charges : ce que le bail ne dit pas, l’expert doit le voir
Depuis 2014, on croise régulièrement dans les baux commerciaux une formule devenue familière : loyer net de toutes charges pour le bailleur. Derrière cette apparente neutralité, le message est clair. Le propriétaire ne veut rien assumer. Entretien, taxes, travaux, gestion, tout passe dans la colonne du locataire. Mais cette construction contractuelle, si elle séduit sur le papier, ne tient pas toujours juridiquement. Elle se heurte à un cadre légal bien plus contraignant que ce que laisse penser sa rédaction.
La loi Pinel, complétée par le décret du 3 novembre 2014, a fixé des bornes à ce transfert de charges. Ces dispositions s’appliquent à tous les baux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014. Elles interdisent notamment de faire supporter au preneur certaines dépenses structurelles, même si les parties l’ont prévu dans le contrat. Les grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil, la mise en conformité liée à la vétusté, les dépenses d’amélioration imposées par la réglementation ou encore les honoraires de gestion liés aux travaux incombant au bailleur ne peuvent être refacturés. Ces exclusions sont d’ordre public. Ce qui signifie qu’elles s’imposent, même en présence d’une clause expresse contraire.
Une autre exigence, souvent négligée, est celle de la transparence. Le bailleur est tenu de remettre au locataire, dès la signature, un état prévisionnel des charges, taxes et redevances imputables. Il doit ensuite produire chaque année un état récapitulatif conforme à l’article R.145-35 du Code de commerce. Ce devoir d’information subsiste, même si le loyer est affiché comme net de charges. En l’absence de cet état, ou en cas de rédaction trop vague, la clause peut être écartée, et le preneur peut demander le remboursement des sommes indûment versées.
La jurisprudence a renforcé cette rigueur. Dans un arrêt du 13 février 2025 (n° 23-17.978), la Cour de cassation a cassé la décision d’une cour d’appel qui avait validé des appels de charges sur la seule base du comportement du preneur. Le locataire s’était acquitté de ces montants pendant neuf ans sans jamais contester. Cela n’a pas suffi. Pour la Cour, la régularité d’un paiement ne vaut pas acceptation tacite. À défaut de stipulation précise, les charges ne peuvent être mises à la charge du locataire. Autrement dit, la seule mention d’un loyer net de charges ne suffit pas à transférer toutes les dépenses, surtout celles visées par le décret de 2014.
Sur le plan fiscal, le raisonnement est tout aussi encadré. Lorsque le locataire prend en charge des dépenses qui reviennent normalement au bailleur, comme des travaux structurels ou de grosses réparations, l’administration fiscale considère qu’il s’agit d’un avantage en nature. Cet avantage est taxable comme un complément de revenu pour le bailleur. Le Conseil d’État l’a rappelé à plusieurs reprises : pour échapper à cette taxation, il faut que le bail prévoie expressément que ces travaux ont été intégrés dans le calcul du loyer. À défaut, le fisc peut imposer une reconstitution du revenu foncier à partir des montants investis par le preneur. Ce point, souvent ignoré lors de la négociation du bail, peut produire des effets rétroactifs non négligeables en cas de contrôle.
En expertise, cette mention de loyer net de toutes charges pour le bailleur oblige à prendre du recul. Il ne suffit pas d’enregistrer le montant du loyer. Il faut le décortiquer. Identifier les charges effectivement supportées par le preneur. Les classer selon leur légalité. Retraiter, le cas échéant, les éléments qui ne peuvent légalement être mis à sa charge. Sans cette vigilance, la valeur locative serait comparée à des loyers non homogènes, faussant les conclusions. La question n’est pas seulement de savoir combien paie le locataire, mais de déterminer ce que ce montant contient réellement, et si ce contenu est conforme au droit.
Cette analyse est d’autant plus importante que certains montages contractuels cherchent, volontairement ou non, à masquer des transferts de charges par des formulations globales. Lorsque le bail ne distingue pas clairement la répartition, c’est à l’expert de poser les limites. Une clause de loyer net peut être interprétée comme une construction équilibrée ou comme une tentative de désengagement unilatéral. Tout dépend de ce qu’elle recouvre réellement, et de ce que le droit permet.
En somme, un loyer net de toutes charges ne dispense pas de l’analyse. Il l’exige. L’expertise ne peut pas se contenter d’une mention contractuelle. Elle doit reconstituer la réalité économique et juridique du bail, ligne par ligne, charge par charge. C’est dans cette rigueur que se construit une valeur locative solide, utilisable, et opposable.