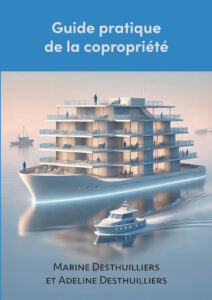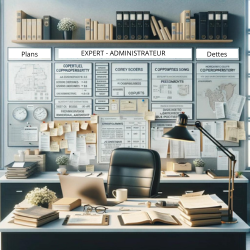Le potin de la semaine
Cette semaine, une question nous a été posée : une personne souhaite revendre son timeshare à la montagne, qu’elle n’a pas utilisé depuis quinze ans. Elle se demande ce que cela vaut encore.
Le timeshare, ou location à temps partagé, c’est ce système qui vous promet une semaine de vacances par an, au même endroit, pour un coût initial raisonnable. On vous vend un petit air de chez soi avec vue sur les sommets, un stylo dans une main, un contrat dans l’autre, et le sentiment d’avoir fait une bonne affaire.
En réalité, ce que l’on achète, ce n’est pas un bout de montagne mais des parts dans une société d’attribution. On devient associé, avec un droit de jouissance, mais surtout des charges, qui continuent de courir même si l’on ne met plus un pied dans l’appartement. Ces charges peuvent être salées : entretien, assurance, ménage, eau chaude, électricité… Et si vous n’y allez pas ? Il faudra le prouver. Certains gestionnaires n’hésitent pas à appeler des fonds forfaitaires, sans détail ni justificatif. Pourtant, la loi de 1986 impose une ventilation précise et un lien avec l’usage réel. Et si vous n’avez pas été convoqué correctement à l’assemblée, les appels de fonds peuvent être remis en cause.
Sortir de ce système relève souvent du casse-tête. Il faut trouver un repreneur, obtenir le vote unanime des associés ou saisir le juge pour faire valoir un juste motif. Des retraités malades vivant à des centaines de kilomètres y parviennent parfois, mais cela suppose des certificats médicaux, des preuves d’inutilisation, et de solides arguments. Un vague ras-le-bol ou la peur de l’altitude ne suffisent pas. Pire encore, certains timeshares se revendent désormais à 0 €, littéralement offerts, car les propriétaires souhaitent simplement se débarrasser des charges annuelles
Et puis il y a la transmission. Au décès du titulaire, les parts se retrouvent dans la succession, avec les charges qui vont avec. Les héritiers découvrent parfois ce cadeau surprise par courrier recommandé, sans avoir jamais vu le logement concerné. La loi permet, dans certains cas, de sortir de la société de plein droit si les parts ont été reçues depuis moins de deux ans. Sinon, les héritiers restent piégés dans la même situation que le défunt.
Alors, faut-il fuir le timeshare ? Pas nécessairement. Mais mieux vaut savoir ce qu’on signe. Lisez les statuts, posez des questions, évaluez la gestion et le marché secondaire. Et surtout, demandez-vous si vous aurez encore envie ou la capacité d’y aller dans dix ou vingt ans.
Chez ADMA, on ne vend pas de semaines de rêve. Mais on peut vous aider à comprendre ce que vous avez acheté ou hérité. Une stratégie bien construite, un bon avocat, un rapport d’expertise, et un peu de ténacité peuvent faire toute la différence.
Perte de chance : le juge ne peut plus détourner le regard
Entre deux missions sur le terrain, on aime bien suivre ce que racontent les juridictions. Et l’arrêt du 27 juin 2025, rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 22-21.146), mérite qu’on s’y attarde. Il remet une pièce dans la machine : dès qu’une perte de chance est caractérisée, le juge doit l’indemniser, même si la partie réclamait à l’origine la réparation intégrale de son préjudice. Plus question de faire l’impasse.
La perte de chance, ce n’est pas une vue de l’esprit : c’est un préjudice à part entière. Le Code civil, via l’article 1240, nous rappelle que toute faute causant un dommage engage la responsabilité. Et cette « disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » pour reprendre la formule consacrée, suffit, dès lors qu’elle repose sur une probabilité raisonnable. Pas besoin que le dommage soit totalement réalisé : il suffit que la faute ait privé la victime d’une réelle possibilité d’éviter une situation défavorable ou d’en tirer un avantage. Le juge n’indemnise donc pas tout le dommage, mais une fraction, en fonction de la chance perdue.
Dans l’affaire jugée, tout commence en 2008. La SCI Les Baobabs achète, par acte notarié, un terrain destiné à accueillir des bureaux. Sauf que le lotissement n’est pas terminé, l’autorisation de vente préalable fait défaut, et le permis de construire s’évapore. Le notaire n’a rien vu, ou plutôt, il n’a rien dit. La SCI assigne donc le notaire pour manquement à son devoir de conseil. La cour d’appel, si elle reconnaît la faute, refuse pourtant l’indemnisation. Motif : la SCI demandait la réparation intégrale de son préjudice (perte d’exploitation, frais engagés), alors qu’il ne s’agirait au mieux que d’une perte de chance… qui n’était pas expressément demandée. Résultat : rejet.
La Cour de cassation n’a pas laissé passer. Elle affirme que le juge peut et doit examiner l’existence d’une perte de chance même si la demande ne visait que la réparation intégrale. À une condition : inviter les parties à s’exprimer sur ce fondement. Et surtout, une fois la perte de chance constatée, le juge ne peut pas refuser de l’indemniser, sous peine de violer les articles 1240 du Code civil et 4 et 5 du Code de procédure civile. Il n’est plus question de se retrancher derrière une erreur de qualification : le juge doit statuer en cohérence avec ce qu’il constate.
Et c’est là que le travail de l’expert prend tout son sens. Car si le juge doit trancher, encore faut-il lui fournir les bons outils. Un bon rapport d’expertise peut faire la différence. Les experts savent calculer la perte de chance. Ils savent modéliser les scénarios perdus, estimer les revenus manqués, chiffrer la probabilité d’un résultat favorable. Ce n’est pas une question d’intuition mais de méthode : projections financières, comparables, études de marché, chronologie des événements… L’expert ne réécrit pas l’histoire, mais il permet au juge d’en mesurer le tournant.
Il ne s’agit pas seulement de dire qu’une chance a été perdue : il faut démontrer ce qu’elle valait. Et plus l’analyse est argumentée, structurée, chiffrée, plus le juge pourra prendre une décision éclairée. C’est aussi ce que rappelle la Cour : l’indemnisation de la perte de chance ne dépend pas de la production de factures, mais de l’existence d’un préjudice. Même si la victime a engagé des frais en connaissance de cause, encore faut-il vérifier si ces dépenses n’étaient pas rendues inévitables par la faute.
Dans la pratique, il devient donc prudent voire indispensable d’intégrer un poste « perte de chance » dans les conclusions. Même à titre subsidiaire. Et d’anticiper la requalification. Cela suppose de bien documenter le contexte : promesse de bail, démarches préparatoires, faisabilité technique ou juridique du projet, autant d’éléments qui permettent de démontrer que l’opportunité était réelle et sérieuse. Ensuite, il faut oser chiffrer la chance perdue, en expliquant les hypothèses, les sources, la méthode.
En clair : la perte de chance n’est pas un filet de secours, ni un artifice procédural. C’est un levier d’indemnisation légitime. Et pour qu’il fonctionne, il faut un dossier solide, un raisonnement rigoureux, et une articulation claire entre les faits, la faute, et la probabilité manquée. Le juge est désormais tenu de réparer. À nous de lui donner les moyens de le faire.