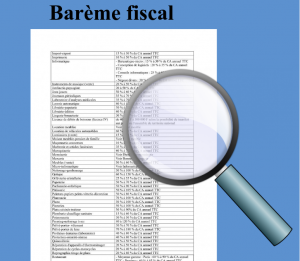Le potin de la semaine
Biens Non Délimités : Quand les limites juridiques s’embrouillent
Dans le cadre d’une expertise judiciaire diligentée suite à une succession, j’ai été mandatée pour définir la valeur vénale de différents biens immobiliers, parmi lesquels figuraient des terrains. Une mission à première vue classique, jusqu’à ce que la lecture attentive des actes me révèle la présence de biens non délimités, des parcelles aux contours flous qui mettent à l’épreuve les règles de la propriété.
Imaginez un terrain qui appartient à plusieurs personnes, mais sans qu’aucune ne sache vraiment où commence et où finit son bout de propriété. Vous visualisez le joli bazar ? Eh bien, bienvenue dans le monde des biens non délimités, ou BND. Ces étranges créatures juridiques, mêlant confusion et droit de propriété, sont une réalité pour bien des praticiens, en particulier les notaires.
Un bien non délimité, c’est une parcelle qui, faute de délimitation précise, rassemble plusieurs propriétés juridiquement indépendantes sous une seule référence cadastrale. Ce micmac naît souvent de l’ignorance des propriétaires sur les limites de leurs terrains, ou de leur refus de participer aux opérations de rénovation cadastrale. Et voilà comment le cadastre, déjà bien occupé, se retrouve à coller l’étiquette « BND » sur des parcelles dont les contours restent flous.
Dans le droit civil, on aime les choses bien carrées. Selon l’article 544 du Code civil, la propriété, c’est « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ». Mais comment être absolu si on ne sait même pas où sont les limites de son terrain ? Heureusement, la jurisprudence est là. Ainsi, dans un arrêt du 20 décembre 1982, la Cour de cassation a tranché : les références cadastrales ne font que présumer les limites, rien de plus.
Pour sortir de cet imbroglio, il y a deux étapes. Premièrement, déterminer les limites des propriétés. Cela peut se faire à l’amiable entre voisins, ou devant le juge en cas de conflit. C’est ici qu’intervient le bornage, prévu à l’article 646 du Code civil, qui permet de fixer les lignes séparatives. Deuxièmement, une fois les limites déterminées, un géomètre-expert établit un document d’arpentage, lequel sera enregistré au cadastre. Et voilà ! Le bien non délimité devient une propriété parfaitement utilisable.
Les notaires, quant à eux, doivent garder les yeux ouverts. Instrumenter un acte sur un bien non délimité demande une certaine vigilance, tant pour s’assurer de la validité de l’opération que pour informer les parties des risques. Le statut BND peut entraîner des contestations sur les droits de propriété ou des litiges sur la nature même du bien. En 2008, la Cour d’appel de Toulouse (15 septembre, n° 07/03728) a décidé que certaines parcelles BND relevaient d’une indivision forcée. Délicat, non ?
Malgré tout, les biens non délimités ne sont pas une fatalité. Leur régularisation est possible – à condition que les propriétaires veuillent bien s’y mettre. Mais soyons honnêtes : entre les coûts du bornage et le manque d’intérêt pour des parcelles souvent peu exploitées, ce statut a la vie dure. Heureusement, les praticiens du droit, avec un peu de patience et de précision, peuvent aider leurs clients à clarifier la situation.
Quand le loyer commercial joue les montagnes russes
23 janvier 2025, Cour de cassation, Pourvoi n° 23-14.887
Les histoires de loyers commerciaux, c’est un peu comme une partie d’échecs : chaque mouvement compte, et parfois, tout se joue sur un détail.
Prenez cette affaire jugée par la cour d’appel de Pau le 9 février 2023. Tout commence par un renouvellement de bail commercial presque banal, mais qui tourne rapidement à la guerre des chiffres entre bailleurs et locataire.
D’un côté, Madame J., locataire d’une pharmacie en centre-ville, demande le renouvellement de son bail arrivé à échéance fin 2015. De l’autre, les bailleurs, Messieurs X. et R. H., acceptent, mais veulent revoir le loyer à la hausse. Et pas qu’un peu ! Leur demande repose sur un déplafonnement prévu par l’article L. 145-34 du Code de commerce. Mais comme on le sait, tout déplafonnement doit être solidement justifié.
Les bailleurs avancent leurs arguments : hausse des taxes foncières (+31 % entre 2007 et 2015), explosion des primes d’assurance responsabilité civile non occupant (+62 % depuis que la loi ALUR de 2014 l’a rendue obligatoire), et revenus locatifs grignotés par ces charges. Avec tout ça, ils estiment que le plafonnement du loyer, ce n’est plus possible.
Madame J., pas du genre à se laisser impressionner, rétorque que tout cela est bien joli, mais que les éléments avancés ne remplissent pas les critères stricts du déplafonnement. Et puis, entre nous, des taxes qui augmentent, c’est le lot de tout le monde, non ? Quant à l’assurance, elle était déjà volontairement souscrite par les bailleurs avant de devenir obligatoire. Pas de quoi en faire un argument choc.
C’est là qu’entre en scène l’expert judiciaire, et sa conclusion apaise quelque peu les ardeurs des bailleurs : la valeur locative réelle est fixée à 8 200 euros par an.
Alors, déplafonnement ou pas ? Oui, tranche la cour. Pourquoi ? Parce que l’augmentation des charges supportées par les bailleurs (taxes, assurance) représente une évolution notable des obligations respectives des parties, suffisante pour justifier la levée du plafonnement. Mais attention, cela ne veut pas dire carte blanche : le loyer final reste basé sur une évaluation raisonnable de la valeur locative.
Madame J. ne s’avoue pas vaincue. Direction la Cour de cassation, où elle conteste notamment l’argument lié à l’assurance. Selon elle, cette charge n’est pas une nouveauté légale, car les bailleurs avaient déjà souscrit cette assurance avant 2014. Peut-on vraiment invoquer une obligation déjà volontairement assumée pour justifier un déplafonnement ?
La réponse de la Cour de cassation est claire : oui. Depuis la loi ALUR, cette assurance est devenue une obligation légale, et son coût accru constitue un élément nouveau. Les juges confirment donc que cette évolution, combinée aux hausses des taxes et autres charges, justifie le déplafonnement. Le montant du loyer, fixé à 8 200 euros par an par la cour d’appel, reste donc inchangé.
Si cette affaire montre que les bailleurs peuvent obtenir un déplafonnement, elle rappelle aussi que ce n’est pas une mince affaire. Entre arguments étayés, expertises et contre-arguments, mieux vaut être préparé. Et pour les locataires ? Rassurez-vous : les juges restent attentifs à éviter les abus. Bref, un vrai jeu d’équilibriste, où chaque partie avance ses pions avec prudence. D’un côté, les bailleurs ont su démontrer que leurs charges avaient évolué de manière significative, obtenant ainsi gain de cause. De l’autre, les locataires peuvent se rassurer : même en cas de déplafonnement, les juges veillent à fixer des montants qui reflètent la réalité de la valeur locative.
Comme souvent en droit, la victoire n’est ni totale, ni absolue.
Quand la propriété se dispute à coups de bornes et de murs
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 23 janvier 2025 – 23-18.821
Les conflits de voisinage autour des limites de propriété sont monnaie courante, et celui-ci, d’abord tranché par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a pris une tournure intéressante devant la Cour de cassation. Une histoire d’empiétements, de bornage et de murs édifiés là où ils n’auraient peut-être pas dû être.
Tout commence avec une propriété acquise en 2006 par les consorts [Y]-[B], jouxtant des parcelles ayant changé de mains en 2005. Les limites entre ces terrains auraient dû être claires, mais la disparition de bornes et l’édification d’un mur en 2009 ont rapidement brouillé les frontières. Les consorts [Y]-[B] ont fait constater ces anomalies par un huissier, révélant deux empiétements : l’un de 30 m² à l’ouest, l’autre de 15 m² à l’est. Après des tentatives infructueuses de bornage amiable, ils ont saisi le juge des référés, demandant la démolition des ouvrages litigieux.
La défense des voisins reposait sur deux piliers. Premièrement, ils contestaient la réalité des empiétements en arguant que les limites étaient mal définies. Deuxièmement, ils invoquaient la prescription acquisitive, soutenant que leur occupation des terrains concernés depuis 2009 leur conférait un droit légitime. La cour d’appel d’Aix-en-Provence n’a pas retenu ces arguments. S’appuyant sur un bornage amiable de 2001 et un procès-verbal de rétablissement des limites de 2021, elle a estimé que les empiétements étaient établis et constituaient un trouble manifestement illicite. Elle a ordonné la démolition des ouvrages en cause.
Cette décision n’a pas convaincu les voisins, qui ont formé un pourvoi en cassation. Ils soutenaient qu’un bornage amiable, même signé par leurs prédécesseurs, ne constituait pas une preuve irréfutable de propriété et que la cour d’appel avait à tort basé sa décision sur ce seul élément.
La Cour de cassation leur a donné raison, rappelant qu’un procès-verbal de bornage ne peut, à lui seul, établir un droit de propriété incontestable. Elle a annulé la décision de la cour d’appel, soulignant que l’existence d’un doute sérieux sur le droit revendiqué par les consorts [Y]-[B] rendait impossible la qualification de trouble manifestement illicite.
L’affaire a été renvoyée devant une nouvelle composition de la cour d’appel pour réexamen. La question des empiétements devra être réévaluée à la lumière des exigences légales sur la preuve de propriété.
Si un bornage amiable peut apaiser les relations entre voisins, il reste fragile en cas de litige. La prudence s’impose donc, tant pour ceux qui souhaitent protéger leurs droits que pour ceux qui contestent les limites imposées.
Quand le congé pour vendre soulève des débats juridiques : l’affaire de la SCI Bénédicte
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 23 janvier 2025 – 23-21.610
La SCI Bénédicte, propriétaire d’un appartement en indivision avec deux autres associés, avait loué ce bien à Monsieur [W] sous plusieurs baux successifs. En juillet 2020, elle délivre un congé pour vendre à son locataire, mentionnant un prix de 1,6 million d’euros. Ce dernier ne donne pas suite à l’offre, se maintient dans les lieux et conteste la validité du congé, notamment en raison de vices de fond et de forme. L’affaire se complique lorsque la SCI Bénédicte assigne le locataire en validation du congé, expulsion et indemnisation, tandis que le locataire contre-attaque pour obtenir l’annulation du congé.
La cour d’appel a examiné les arguments des parties, se concentrant sur deux points : la validité du congé et les obligations des indivisaires. La SCI Bénédicte soutenait que tous les indivisaires avaient donné leur accord pour délivrer le congé, car ils étaient aussi ses principaux associés. La cour a estimé que le congé était valable, rejetant les arguments de Monsieur [W], notamment ceux sur un prétendu prix dissuasif. Le prix mentionné dans le congé ne semblait pas excessif au regard des ventes réalisées dans le même immeuble.
La cour a également rejeté la demande de nullité des baux précédemment signés, considérant qu’ils avaient été valablement conclus par la SCI, avec des pouvoirs délégués à son gérant. En conséquence, elle a confirmé que le locataire était occupant sans droit ni titre à compter du 1er février 2021 et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer.
Cependant, cette décision s’appuyait sur l’idée que l’accord tacite des indivisaires pour délivrer le congé suffisait à le valider. Ce raisonnement a été remis en question devant la Cour de cassation.
Saisie par le locataire, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel sur la validité du congé. Elle a rappelé que, selon l’article 815-3 du Code civil, un acte de disposition sur un bien indivis – tel qu’un congé pour vendre – nécessite le consentement exprès de tous les indivisaires. Or, la cour d’appel n’avait pas établi que chaque indivisaire avait donné son accord explicite pour la délivrance du congé.
En l’absence d’une telle constatation, la Cour de cassation a jugé que la décision de la cour d’appel manquait de base légale. Elle a renvoyé l’affaire devant une autre composition de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour réexamen.
Même lorsque les indivisaires sont étroitement liés, comme dans le cas d’une SCI, leur consentement explicite reste indispensable.